Collagène de méduse : une ressource marine à haute valeur ajoutée ?
Dermatologie et Vénérologie
Par Ana Espino | Publié le 05 Août 2025| 2 min de lecture
#Méduse #Collagène #Cosmétique #Bioressource
Les méduses, souvent perçues comme nuisibles, prolifèrent massivement en Méditerranée à la faveur du changement climatique et de la surpêche. Cette explosion démographique soulève des préoccupations écologiques et économiques. Cependant, elle pourrait également représenter une opportunité biotechnologique inédite, notamment par l’exploitation du collagène qu’elles contiennent.
Le collagène, largement utilisé dans l’industrie biomédicale et cosmétique, provient aujourd’hui principalement de sources bovines, porcines ou marines classiques, avec des enjeux éthiques, religieux, ou liés à des risques zoonotiques. Le collagène de méduse (notamment Rhizostoma pulmo) apparaît comme une alternative prometteuse, biocompatible, durable et sans risque zoonotique connu.
Pourtant, sa valorisation reste limitée par le manque de standardisation, de données toxicologiques et de compréhension de ses propriétés biochimiques comparées aux collagènes conventionnels. Dans ce contexte, cette étude a été initiée afin d’explorer le potentiel du collagène de méduse comme ressource biomédicale et cosmétique durable, en évaluant ses propriétés structurelles, ses applications, et les verrous techniques à surmonter.
Les résultats expérimentaux - issus de projets comme GoJelly, Blue Bio Med ou MED-JELLYRISK - confirment le potentiel multifonctionnel du collagène extrait de méduses, en particulier Rhizostoma pulmo. Ce collagène se distingue par sa biocompatibilité élevée, sa faible immunogénicité et sa capacité à soutenir la prolifération cellulaire, le rendant adapté à des applications en culture cellulaire, médecine régénérative et ingénierie cutanée. Il peut être transformé en hydrogels, membranes, éponges ou matrices 3D, offrant une grande flexibilité de formulation. Par ailleurs, ses propriétés gélifiantes, filmogènes et hydratantes ouvrent des perspectives prometteuses en cosmétique naturelle et dans la conception de soins dermatologiques innovants.
Néanmoins, plusieurs obstacles freinent son intégration à grande échelle : l’absence de normes de production industrielles, une variabilité importante entre les espèces et les lots, la saisonnalité de la ressource, et le manque de données toxicologiques et cliniques nécessaires à l’obtention d’autorisations réglementaires en santé humaine.
L’accumulation massive de méduses en Méditerranée, souvent perçue comme une nuisance écologique, soulève des enjeux majeurs de gestion environnementale. Pourtant, des travaux récents suggèrent qu’elles pourraient aussi devenir une source précieuse de biomatériaux, notamment sous forme de collagène. Le principal défi réside dans la valorisation industrielle de cette biomasse encore peu exploitée. L’absence de protocoles de production standardisés, la variabilité interspécifique, la saisonnalité des récoltes et les incertitudes réglementaires freinent actuellement son intégration dans les filières biomédicales et cosmétiques.
Cette revue visait à faire le point sur les connaissances actuelles autour du collagène de méduse, en analysant ses propriétés biochimiques, son potentiel d’application et les obstacles à surmonter pour sa mise en œuvre. Les données disponibles confirment qu’il s’agit d’un matériau prometteur : biocompatible, faiblement immunogène, modulable sous divers formats (hydrogels, membranes, films), et adapté à des usages en médecine régénérative et en dermocosmétique.
En s’appuyant sur ces avancées, transformer le collagène de méduse en ressource industrielle durable nécessitera une coordination étroite entre recherche scientifique, ingénierie des procédés et validation réglementaire, afin d’en faire un véritable levier d’innovation circulaire.
À lire également :
À propos de l'auteure – Ana Espino
Docteure en immunologie, spécialisée en virologie
Rédactrice scientifique, Ana est animée par la volonté de relier la recherche à l’impact concret. Spécialiste en immunologie, virologie, oncologie et études cliniques, elle s’attache à rendre la science complexe claire et accessible. Sa mission : accélérer le partage des savoirs et favoriser des décisions éclairées grâce à une communication percutante.
#Méduse #Collagène #Cosmétique #Bioressource
Les méduses, souvent perçues comme nuisibles, prolifèrent massivement en Méditerranée à la faveur du changement climatique et de la surpêche. Cette explosion démographique soulève des préoccupations écologiques et économiques. Cependant, elle pourrait également représenter une opportunité biotechnologique inédite, notamment par l’exploitation du collagène qu’elles contiennent.
Le collagène, largement utilisé dans l’industrie biomédicale et cosmétique, provient aujourd’hui principalement de sources bovines, porcines ou marines classiques, avec des enjeux éthiques, religieux, ou liés à des risques zoonotiques. Le collagène de méduse (notamment Rhizostoma pulmo) apparaît comme une alternative prometteuse, biocompatible, durable et sans risque zoonotique connu.
Pourtant, sa valorisation reste limitée par le manque de standardisation, de données toxicologiques et de compréhension de ses propriétés biochimiques comparées aux collagènes conventionnels. Dans ce contexte, cette étude a été initiée afin d’explorer le potentiel du collagène de méduse comme ressource biomédicale et cosmétique durable, en évaluant ses propriétés structurelles, ses applications, et les verrous techniques à surmonter.
Le collagène de méduse est-il prêt pour les labos et les crèmes ?
Les résultats expérimentaux - issus de projets comme GoJelly, Blue Bio Med ou MED-JELLYRISK - confirment le potentiel multifonctionnel du collagène extrait de méduses, en particulier Rhizostoma pulmo. Ce collagène se distingue par sa biocompatibilité élevée, sa faible immunogénicité et sa capacité à soutenir la prolifération cellulaire, le rendant adapté à des applications en culture cellulaire, médecine régénérative et ingénierie cutanée. Il peut être transformé en hydrogels, membranes, éponges ou matrices 3D, offrant une grande flexibilité de formulation. Par ailleurs, ses propriétés gélifiantes, filmogènes et hydratantes ouvrent des perspectives prometteuses en cosmétique naturelle et dans la conception de soins dermatologiques innovants.
Néanmoins, plusieurs obstacles freinent son intégration à grande échelle : l’absence de normes de production industrielles, une variabilité importante entre les espèces et les lots, la saisonnalité de la ressource, et le manque de données toxicologiques et cliniques nécessaires à l’obtention d’autorisations réglementaires en santé humaine.
Une ressource marine à apprivoiser
L’accumulation massive de méduses en Méditerranée, souvent perçue comme une nuisance écologique, soulève des enjeux majeurs de gestion environnementale. Pourtant, des travaux récents suggèrent qu’elles pourraient aussi devenir une source précieuse de biomatériaux, notamment sous forme de collagène. Le principal défi réside dans la valorisation industrielle de cette biomasse encore peu exploitée. L’absence de protocoles de production standardisés, la variabilité interspécifique, la saisonnalité des récoltes et les incertitudes réglementaires freinent actuellement son intégration dans les filières biomédicales et cosmétiques.
Cette revue visait à faire le point sur les connaissances actuelles autour du collagène de méduse, en analysant ses propriétés biochimiques, son potentiel d’application et les obstacles à surmonter pour sa mise en œuvre. Les données disponibles confirment qu’il s’agit d’un matériau prometteur : biocompatible, faiblement immunogène, modulable sous divers formats (hydrogels, membranes, films), et adapté à des usages en médecine régénérative et en dermocosmétique.
En s’appuyant sur ces avancées, transformer le collagène de méduse en ressource industrielle durable nécessitera une coordination étroite entre recherche scientifique, ingénierie des procédés et validation réglementaire, afin d’en faire un véritable levier d’innovation circulaire.
À lire également :
À propos de l'auteure – Ana Espino
Docteure en immunologie, spécialisée en virologie

Dernières revues
Insomnie : quel Qi Gong choisir ?Insomnie : quel Qi Gong choisir ?

#Sommeil #Insomnie #MedecineTraditionnelle #MTC L’insomnie...
La graisse qui sauve les bébés : zoom sur le rôle de BMP8B dans la lutte contre le froid

#TissusAdipeuxBrun #SantéduNouveauNé #endocrinologie #Pédiatrie #Métabolis...
Thérapies gonadotoxiques : l’utérus garde-t-il des séquelles durables ?
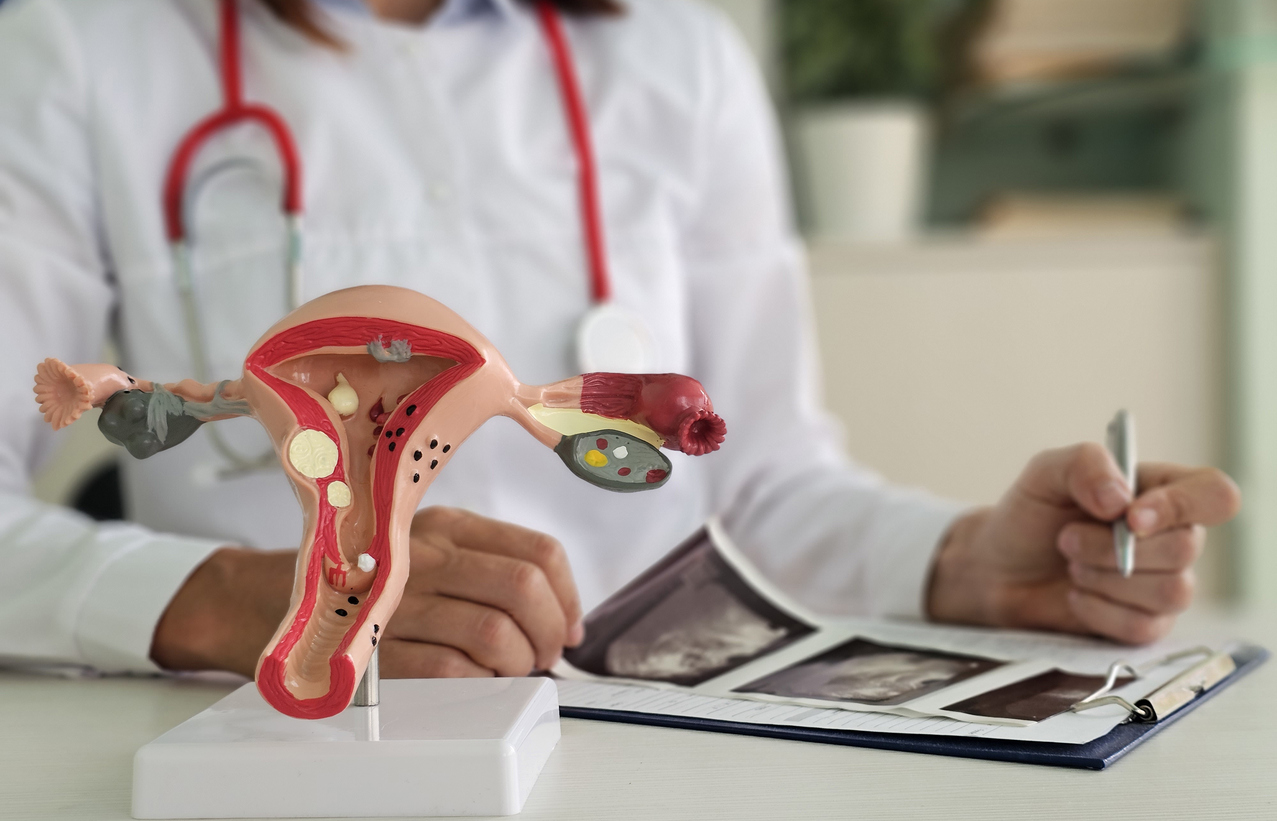
#Fertilité #Gynécologie #Chimiothérapie #Endocrinologie <br>