Revues de presse
#TSA #HDtDCS
#Neuromodulation #HypersensibilitéSensorielle #CognitionSociale
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont des troubles neurodéveloppementaux caractérisés par des difficultés persistantes dans les interactions sociales, la communication, et les comportements répétitifs ou restreints. Chez de nombreux enfants autistes, ces symptômes s’accompagnent d’a...
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont des troubles neurodéveloppementaux caractérisés par des difficultés persistantes dans les interactions sociales, la communication, et les comportements répétitifs ou restreints. Chez de nombreux enfants autistes, ces symptômes s’accompagnent d’a...
Lire la suite

#AutismeSansDéficienceIntellectuelle
#TMS #CognitionSociale #iTBS #Neuroimagerie
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) se manifestent principalement par des difficultés persistantes dans les interactions sociales, la communication et la compréhension des intentions d’autrui. Chez les adultes, ces difficultés sociales sont souvent marquées et impactent les relations interpe...
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) se manifestent principalement par des difficultés persistantes dans les interactions sociales, la communication et la compréhension des intentions d’autrui. Chez les adultes, ces difficultés sociales sont souvent marquées et impactent les relations interpe...
Lire la suite

#Autisme
#Mitochondries #Supplémentation #FonctionCognitive #ÉnergieCellulaire
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont des pathologies neurodéveloppementales complexes, caractérisées par des difficultés persistantes dans la communication sociale, des comportements répétitifs et des intérêts restreints. Leur prévalence est en constante augmentation. 1 enfant sur 36&nbs...
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont des pathologies neurodéveloppementales complexes, caractérisées par des difficultés persistantes dans la communication sociale, des comportements répétitifs et des intérêts restreints. Leur prévalence est en constante augmentation. 1 enfant sur 36&nbs...
Lire la suite

#CancerColorectal
#Immunothérapie #ICI #XL888 #Bithérapie
Le cancer colorectal (CRC) figure parmi les principales causes de mortalité par cancer dans le monde, en particulier à un stade avancé où les options thérapeutiques deviennent limitées. L’avènement de l’immunothérapie, en particulier les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI), a transformé le traitement de...
Le cancer colorectal (CRC) figure parmi les principales causes de mortalité par cancer dans le monde, en particulier à un stade avancé où les options thérapeutiques deviennent limitées. L’avènement de l’immunothérapie, en particulier les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI), a transformé le traitement de...
Lire la suite

#EndométrioseProfonde #Fertilité #ChirurgieColorectale
#PréservationFertilité #Grossesse
L’endométriose rectale profonde (DEIR) représente une forme avancée et particulièrement invalidante d’endométriose, dans laquelle les lésions infiltrent la paroi du rectum. Elle est fréquemment associée à des symptômes digestifs sévères (douleurs à la défécation, constipation, diarrhée, syndrom...
L’endométriose rectale profonde (DEIR) représente une forme avancée et particulièrement invalidante d’endométriose, dans laquelle les lésions infiltrent la paroi du rectum. Elle est fréquemment associée à des symptômes digestifs sévères (douleurs à la défécation, constipation, diarrhée, syndrom...
Lire la suite
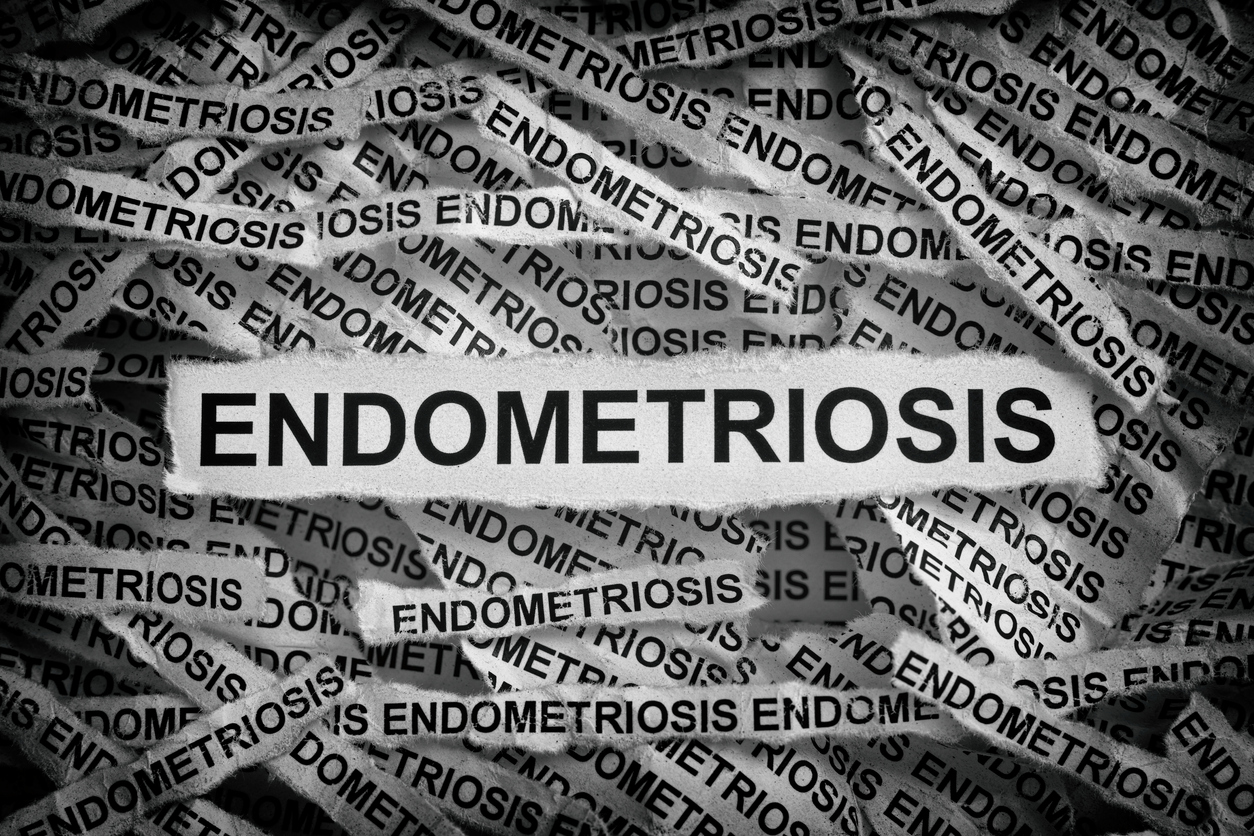
#Endométriose #DouleursPelviennes #ActivitéPhysique #SantéMentale
#MétaAnalyse
L’endométriose est une maladie gynécologique chronique et inflammatoire caractérisée par la présence anormale de tissu endométrial en dehors de la cavité utérine, souvent au niveau du péritoine, des ovaires ou du rectum. Elle touche environ 1 femme sur 10 en âge de procréer et représente l’une des pr...
L’endométriose est une maladie gynécologique chronique et inflammatoire caractérisée par la présence anormale de tissu endométrial en dehors de la cavité utérine, souvent au niveau du péritoine, des ovaires ou du rectum. Elle touche environ 1 femme sur 10 en âge de procréer et représente l’une des pr...
Lire la suite

#Endométriose
#Acupuncture #DouleurPelvienne #MédecineAlternative #MétaAnalyse
L’endométriose est une maladie gynécologique chronique et inflammatoire, caractérisée par la présence de tissu endométrial en dehors de l’utérus. Elle touche près de 10 % des femmes en âge de procréer et se manifeste souvent par des douleurs pelviennes chroniques, une dysménorrhée sévère, des trouble...
L’endométriose est une maladie gynécologique chronique et inflammatoire, caractérisée par la présence de tissu endométrial en dehors de l’utérus. Elle touche près de 10 % des femmes en âge de procréer et se manifeste souvent par des douleurs pelviennes chroniques, une dysménorrhée sévère, des trouble...
Lire la suite
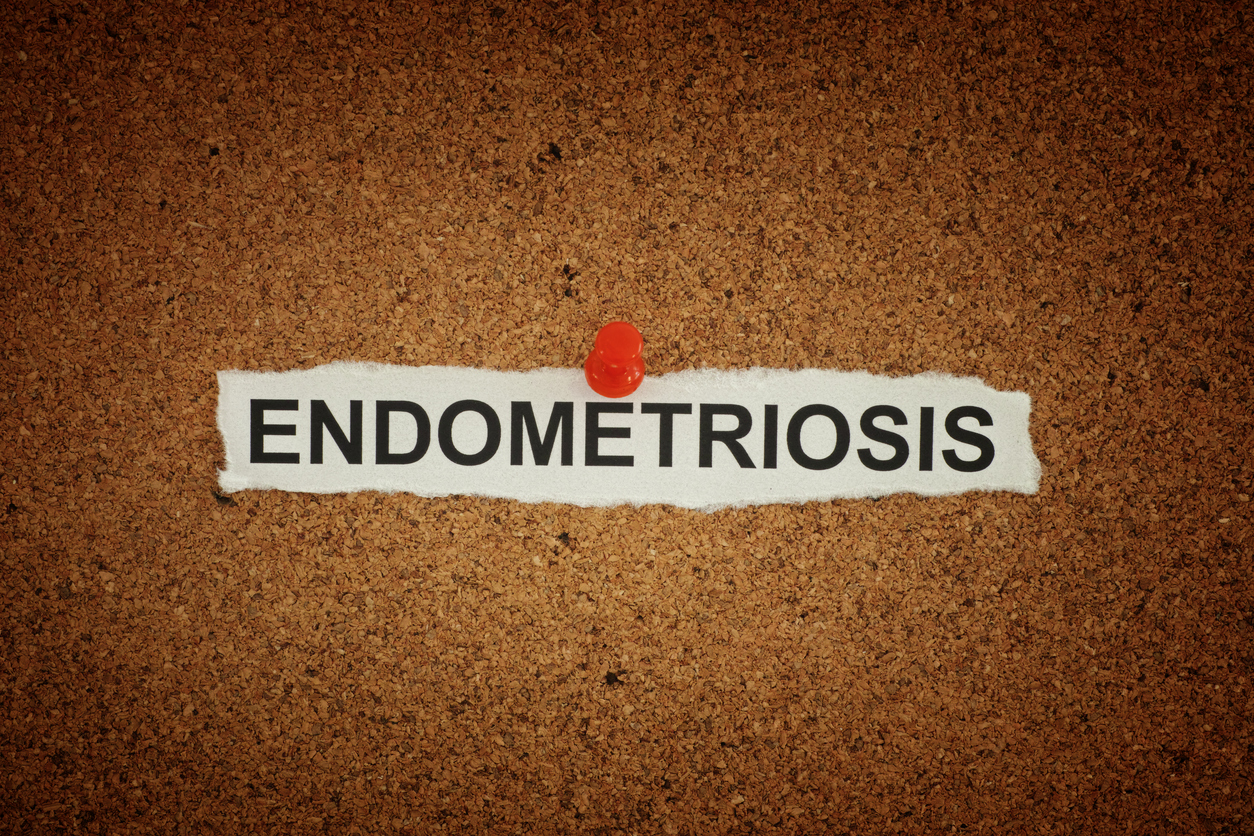
#Anémie #Espace
#Microgravité #Hémolyse #RBC #Astronautes
L’anémie spatiale est un phénomène bien connu chez les astronautes, observé dès les premières missions habitées. Elle se manifeste par une diminution du nombre de globules rouges et de la concentration en hémoglobine, qui peut affecter la capacité de transport de l’oxygène, la performance physique et la récupé...
L’anémie spatiale est un phénomène bien connu chez les astronautes, observé dès les premières missions habitées. Elle se manifeste par une diminution du nombre de globules rouges et de la concentration en hémoglobine, qui peut affecter la capacité de transport de l’oxygène, la performance physique et la récupé...
Lire la suite

#CancerColorectal
#AKI #Chirurgie #RisqueOpératoire #FacteursDeRisque #SoinsPostOpératoires
L’insuffisance rénale aiguë (AKI) survenant après une intervention chirurgicale est une complication fréquente, en particulier dans les chirurgies majeures comme celles pratiquées en oncologie digestive. Elle est associée à une mortalité accrue, à des durées d’hospitalisation prolongées,...
L’insuffisance rénale aiguë (AKI) survenant après une intervention chirurgicale est une complication fréquente, en particulier dans les chirurgies majeures comme celles pratiquées en oncologie digestive. Elle est associée à une mortalité accrue, à des durées d’hospitalisation prolongées,...
Lire la suite

#Tuberculose #MDRTB #TraitementOral #Bedaquiline #Efficacité #Sécurité
La tuberculose multirésistante (MDR-TB) est une forme particulièrement préoccupante de tuberculose, définie par une résistance à l’isoniazide et à la rifampicine, les deux médicaments de base du traitement antituberculeux. Elle est responsable de centaines de milliers de cas chaque année dans le monde, et rep...
La tuberculose multirésistante (MDR-TB) est une forme particulièrement préoccupante de tuberculose, définie par une résistance à l’isoniazide et à la rifampicine, les deux médicaments de base du traitement antituberculeux. Elle est responsable de centaines de milliers de cas chaque année dans le monde, et rep...
Lire la suite
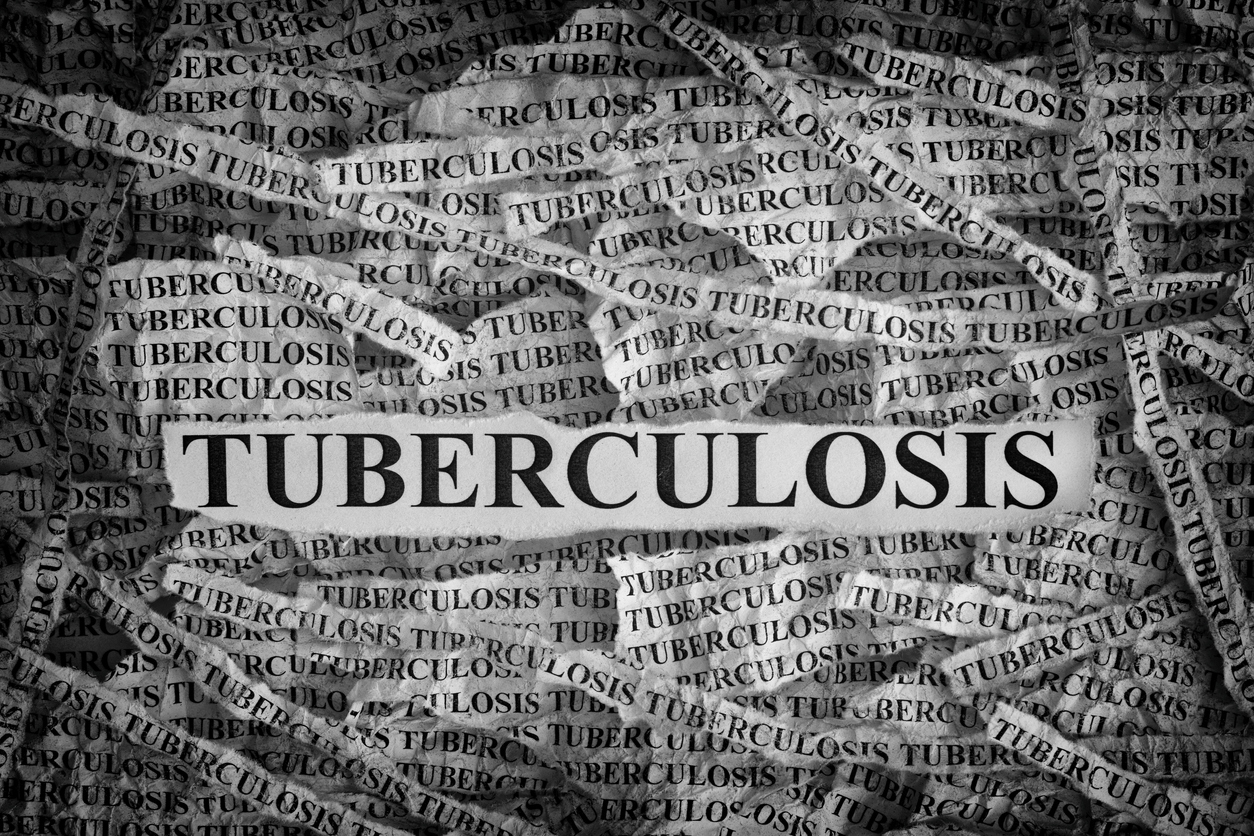
#Tuberculose #Diabète #Rifapentine #TraitementCourt #Moxifloxacine #Sécurité
La tuberculose (TB) et le diabète représentent deux problèmes de santé publique majeurs à l’échelle mondiale, avec une forte prévalence et un impact important sur la morbidité et la mortalité. Lorsqu’elles coexistent chez un même patient, ces pathologies interagissent de manière négative et synergique,...
La tuberculose (TB) et le diabète représentent deux problèmes de santé publique majeurs à l’échelle mondiale, avec une forte prévalence et un impact important sur la morbidité et la mortalité. Lorsqu’elles coexistent chez un même patient, ces pathologies interagissent de manière négative et synergique,...
Lire la suite
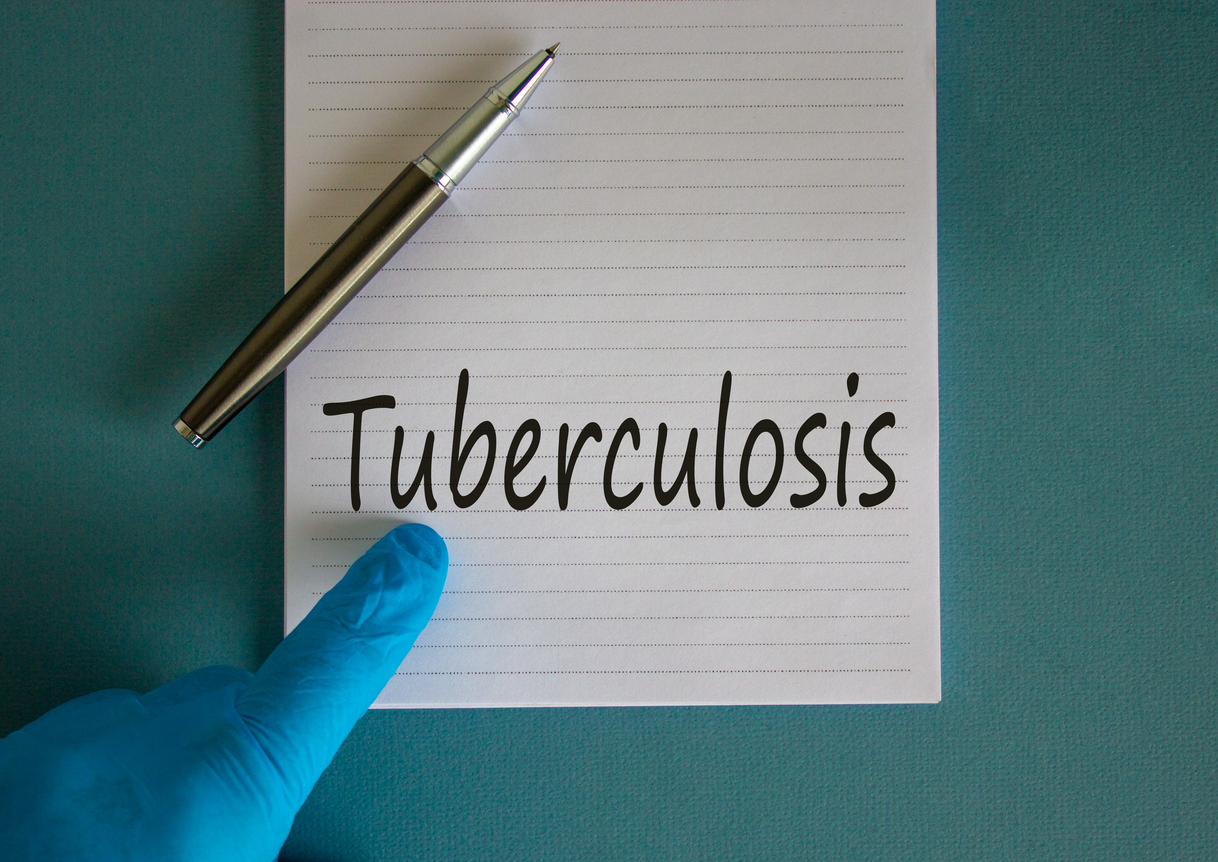
#CancerColorectal #Chimiothérapie #Cetuximab #AntiEGFR #Survie #TraitementCiblé
Le cancer colorectal métastatique (mCRC) est une forme avancée et agressive du cancer colorectal. Elle est caractérisée par la dissémination des cellules tumorales vers d’autres organes, notamment le foie et les poumons. Son pronostic est faible, avec un taux de survie à 5 ans estimé à seul...
Le cancer colorectal métastatique (mCRC) est une forme avancée et agressive du cancer colorectal. Elle est caractérisée par la dissémination des cellules tumorales vers d’autres organes, notamment le foie et les poumons. Son pronostic est faible, avec un taux de survie à 5 ans estimé à seul...
Lire la suite

#Alzheimer #Génétique #Neurodégénérescence #MédecinePrécision #GWAS #MultiAncestral
La maladie d'Alzheimer (MA) est la forme de démence la plus courante, touchant des millions de personnes dans le monde. Elle se caractérise par un déclin progressif des fonctions cognitives, affectant la mémoire, le langage et les capacités d’orientation....
La maladie d'Alzheimer (MA) est la forme de démence la plus courante, touchant des millions de personnes dans le monde. Elle se caractérise par un déclin progressif des fonctions cognitives, affectant la mémoire, le langage et les capacités d’orientation....
Lire la suite

#Délirium #Chirurgie #Mélatonine #Prévention #Cognition #Sommeil #Gériatrie #Anesthésie
Le délirium postopératoire (DPO) est un trouble fréquent chez les patients âgés après une chirurgie. Il se manifeste par des troubles de l’attention, de la perception et de la cognition. Il pouvant entraîner des complications graves. Le...
Le délirium postopératoire (DPO) est un trouble fréquent chez les patients âgés après une chirurgie. Il se manifeste par des troubles de l’attention, de la perception et de la cognition. Il pouvant entraîner des complications graves. Le...
Lire la suite

#Suicide #VitamineD #Dépression #Neuroprotection #Inflammation #Carence #Supplémentation #Prévention #SantéMentale #ComportementSuicidaire
Le suicide est un problème de santé publique majeur, causant près de 700 000 décès par an dans le monde. Il résulte d’une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et en...
Le suicide est un problème de santé publique majeur, causant près de 700 000 décès par an dans le monde. Il résulte d’une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et en...
Lire la suite
