15/07/2025
Des virus dans nos intestins, un cœur en danger ?
Cardiologie et Médecine Vasculaire Endocrinologie et Métabolisme Infectiologie
#MCV #virome #virus #microbiote
Les maladies cardiovasculaires (MCV) demeurent la première cause de mortalité dans le monde, représentant un enjeu de santé publique majeur, en particulier chez les personnes âgées. Jusqu’à présent, la recherche s’est principalement orientée vers l’étude de facteurs de risque traditionnels tels que la génétique, les habitudes alimentaires ou encore les déséquilibres du microbiote bactérien intestinal. Toutefois, une nouvelle dimension suscite un intérêt croissant : le virome intestinal, c’est-à-dire l’ensemble des virus présents dans notre tube digestif, incluant principalement des bactériophages et des virus eucaryotes.
Malgré leur abondance, ces virus restent largement absents des approches diagnostiques et thérapeutiques actuelles. Leur diversité génétique extrême, combinée à l’absence de bases de données viromiques complètes et à la complexité de leurs interactions avec le microbiote bactérien, l’immunité de l’hôte et les mécanismes métaboliques, rend leur étude particulièrement ardue. Ces lacunes scientifiques freinent une compréhension intégrée du rôle potentiel du virome dans la santé cardiovasculaire.
Dans ce contexte, cette étude a été initiée de sorte à examiner le rôle du virome intestinal dans la genèse et la progression des MCV. Elle propose d’élargir le paradigme actuel, en intégrant la composante virale au sein des modèles pathogéniques cardiovasculaires, et en ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la prévention, le diagnostic et l’intervention thérapeutique dans ce domaine.
Le virome, maître caché de notre santé cardiovasculaire ?
Les études sélectionnées incluent des analyses métagénomiques sur des échantillons humains et animaux, mettant en lumière la présence accrue d’entérovirus et de phages dans différents types de MCV.
Les études sélectionnées ont permis de mettre en évidence une modification significative de la composition du virome intestinal chez les patients atteints de diverses formes de MCV. En cas d’hypertension, une forte prévalence d’entérovirus, notamment le coxsackievirus, ainsi que la présence de phages spécifiques, a été observée. Concernant l’athérosclérose et les cardiopathies coronariennes, les données ont révélé une altération profonde de la structure du virome, avec une augmentation marquée de familles virales comme les Siphoviridae et les Virgaviridae.
Dans la fibrillation auriculaire, les chercheurs ont identifié des signatures viromiques distinctes, suggérant un rôle potentiel dans la stratification des patients à risque. Enfin, des altérations notables du virome ont également été relevées dans l’insuffisance cardiaque et les myocardites virales, en particulier une prolifération de phages entérocoques et la présence persistante de coxsackievirus B3, étroitement lié à la pathogenèse myocardique. Ces résultats appuient l’hypothèse selon laquelle les virus intestinaux pourraient jouer un rôle actif dans les déséquilibres cardiovasculaires via des mécanismes immunitaires, inflammatoires et métaboliques.
Et maintenant, que faire du virome ?
Les maladies cardiovasculaires englobent des affections majeures telles que l’hypertension, l’athérosclérose et l’insuffisance cardiaque. Pourtant, la compréhension de leur lien potentiel avec le virome intestinal reste entravée par la complexité génétique des virus, les limites actuelles des technologies de séquençage et l’absence de bases de données viromiques robustes. De surcroît, établir une relation de causalité claire entre le virome et les MCV demeure un défi méthodologique majeur.
L’objectif de cette étude était d’analyser de manière systématique l’implication du virome intestinal dans les MCV et de proposer une approche intégrative qui dépasse le paradigme bactérien traditionnel. Cette exploration pionnière met en lumière le rôle potentiel du virome comme cible thérapeutique innovante. Son influence sur les réponses immunitaires, les mécanismes inflammatoires et le métabolisme cardiaque justifie une attention renforcée.
Cependant, plusieurs limites subsistent : la taille réduite des échantillons étudiés, l’hétérogénéité des méthodes employées et le manque d’études longitudinales limitent la portée des conclusions actuelles. Pour progresser, il est essentiel de développer des technologies de séquençage plus performantes, de mener des cohortes longitudinales rigoureuses, d’intégrer le virome dans les stratégies de médecine préventive et d’explorer les opportunités thérapeutiques qu’offre sa modulation, notamment par les prébiotiques ou la transplantation virale.
À lire également : Les maladies cardiovasculaires : 1ère cause de mortalité féminine en France
À propos de l'auteure – Ana Espino
Docteure en immunologie, spécialisée en virologie
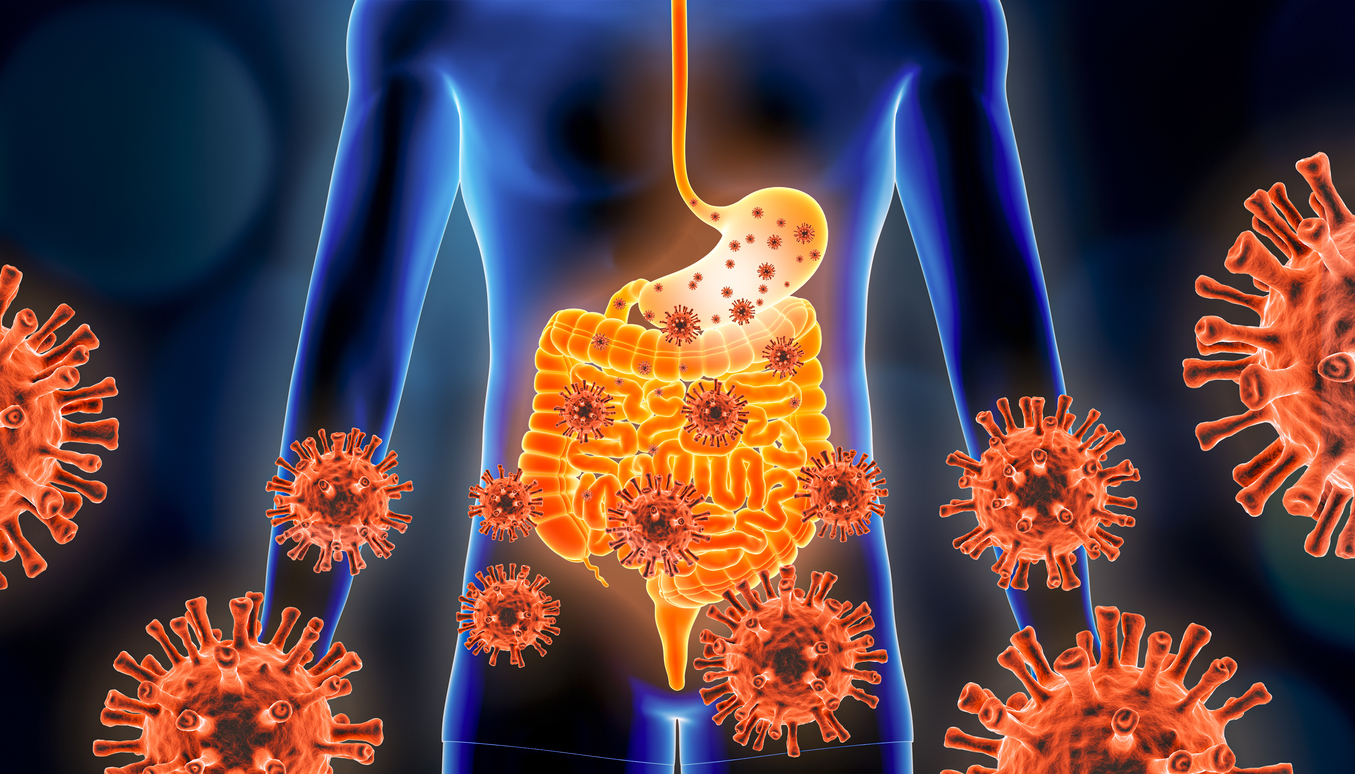
Dernières revues
La lèpre : une maladie encore hors de contrôle

Par Ana Espino | Publié le 22 janvier 2026 | 3 min de lecture
L’intoxication alcoolique parentale : un impact caché sur la santé mentale des enfants

Par Carolina Lima | Publié le 19 janvier 2026 | 3 min de lecture
Obésité : quand les reins saturent

Par Ana Espino | Publié le 20 janvier 2026 | 3 min de lecture