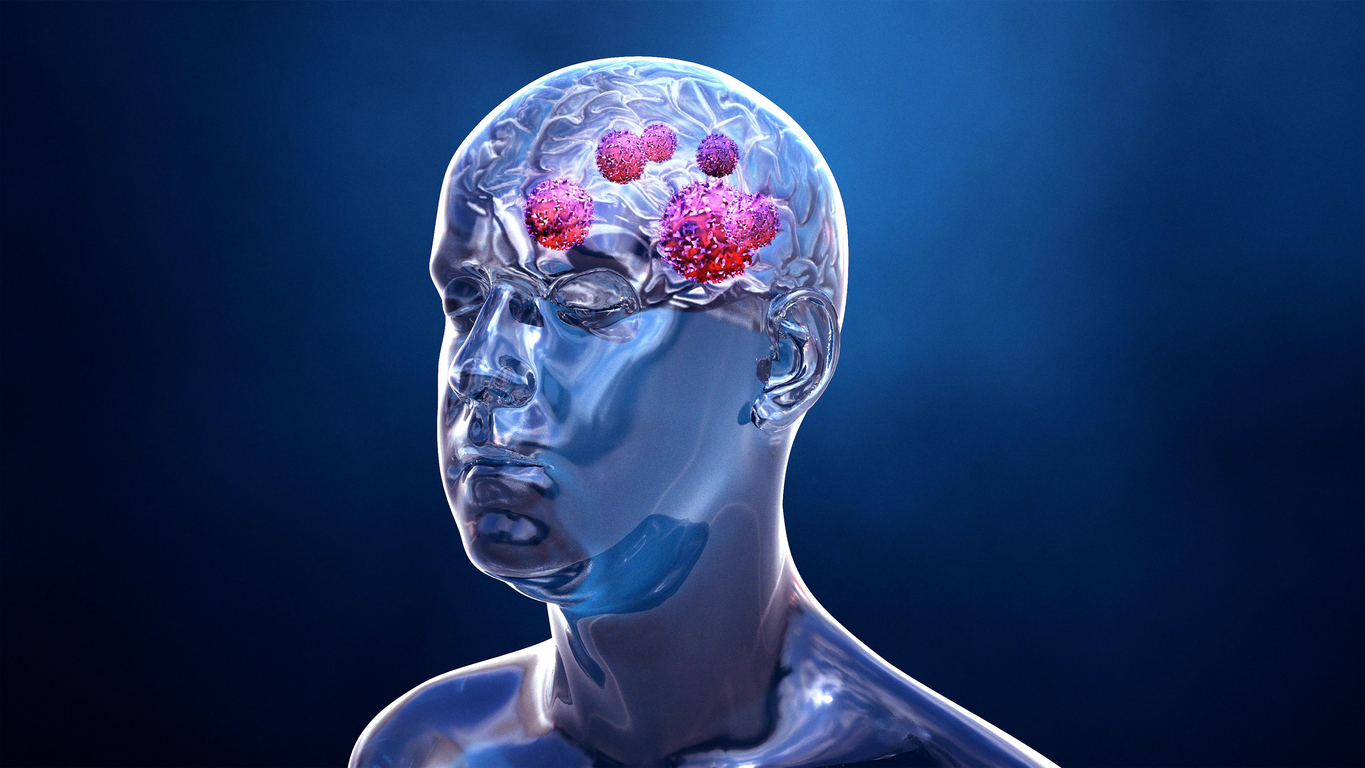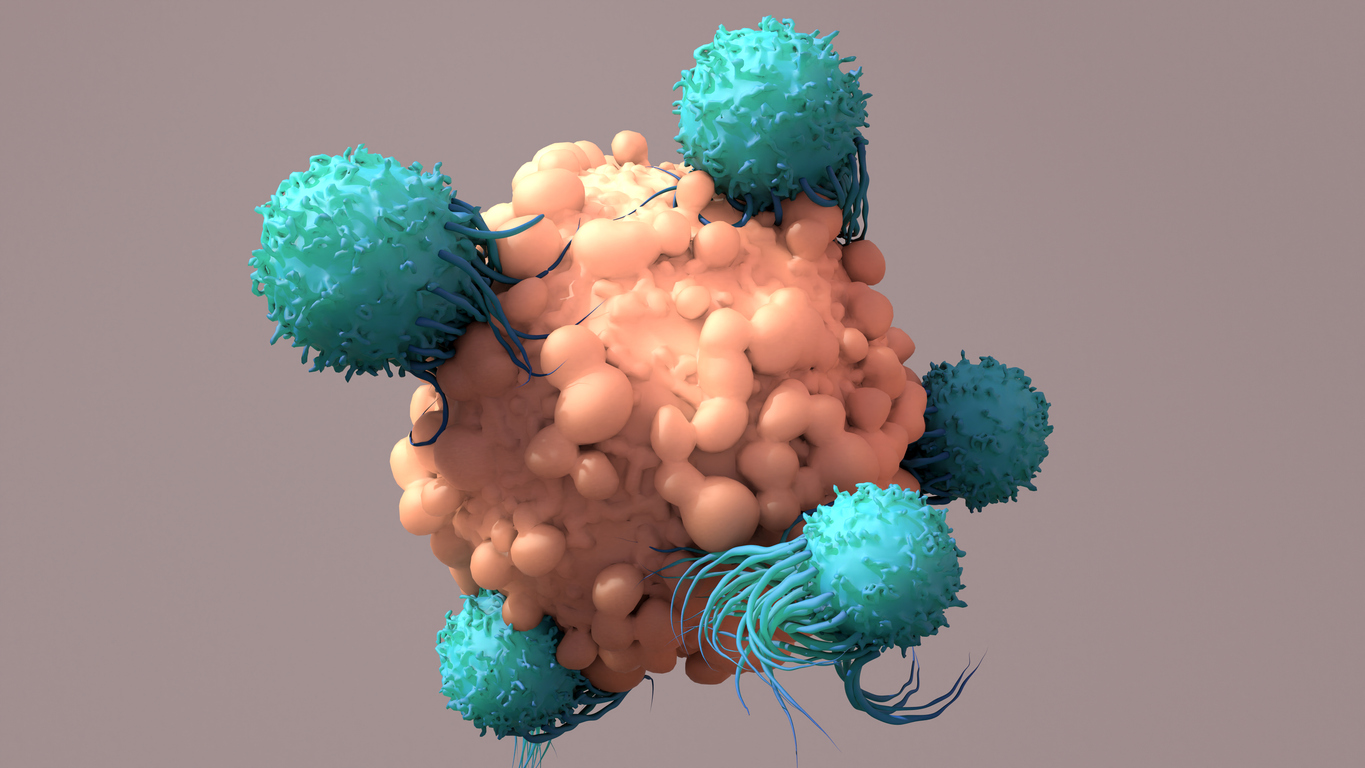Le cancer du sein est la
tumeur la plus fréquente chez la femme dans le monde. Malgré les progrès
thérapeutiques, une part importante des patientes traitées reste à risque de
rechute, notamment celles qui conservent une maladie résiduelle après un
traitement néoadjuvant. Cette maladie résiduelle est un facteur pronostique
majeur de récidive précoce, en particulier dans les sous-types agressifs comme
le cancer du sein triple-négatif ou HER2+. La détection précoce de cette
maladie résiduelle ou de la rechute imminente représente un enjeu crucial pour
améliorer la prise en charge personnalisée et la survie globale.
Dans ce contexte, le ctDNA
(ADN tumoral circulant) s’impose comme un outil prometteur de surveillance
moléculaire. Il permettrait de détecter des traces de maladie avant toute
manifestation clinique ou radiologique, et d’adapter précocement les
stratégies thérapeutiques. Cependant, l’accès à cette technologie innovante
reste profondément inégal, tant sur le plan géographique que socio-économique.
Les populations issues de milieux ruraux ou vivant dans des pays
à revenu faible ou intermédiaire sont moins incluses dans les essais,
moins testées, et moins susceptibles de bénéficier de thérapies
ciblées basées sur le ctDNA.
Cette étude a été initiée de
sorte à analyser les inégalités d’accès, d’utilisation et de représentation
autour du ctDNA dans le cancer du sein, afin de proposer des pistes concrètes
pour une médecine de précision plus équitable.
Le ctDNA est-il vraiment
pour toutes ?
L’étude révèle plusieurs couches
d’inégalités. Sur le plan biologique, certaines populations présentent des
profils génétiques distincts (mutations TP53 fréquentes, altérations CCND2,
etc.), ce qui peut influencer la libération ou la détection du ctDNA. D’un
point de vue structurel, des inégalités persistantes dans l’accès à la biologie
moléculaire (coût, assurance, géographie) freinent l’utilisation des tests. En
pratique clinique, les femmes noires reçoivent moins souvent des thérapies
ciblées malgré des altérations identifiées. De plus, elles sont largement
absentes des essais cliniques utilisant le ctDNA, limitant la généralisabilité
des résultats. Enfin, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (Ghana,
Inde, Chine), des études pilotes montrent que le ctDNA est techniquement
faisable mais confronté à des obstacles d’infrastructure.
Pas de médecine de
précision sans équité
Le cancer du sein,
première cause de cancer chez la femme, reste marqué par un risque de
rechute significatif, notamment chez les patientes avec maladie
résiduelle après traitement initial. Le principal challenge réside
dans la détection précoce de ces rechutes potentielles, par des outils
sensibles, accessibles et validés, sans aggraver les inégalités existantes.
Cette étude visait à évaluer
les usages, performances et limites du ctDNA en oncologie mammaire, tout en
mettant en lumière les disparités structurelles et biologiques affectant
son déploiement. Elle souligne que le ctDNA représente une avancée majeure,
mais encore inégalement déployée, avec un risque de renforcer les écarts de
prise en charge si des mesures correctives ne sont pas mises en place.
Les limites résident dans
le manque de données robustes issues de populations non-blanches ou vivant
en PRFI, ainsi que dans l’absence de standards universels pour
l’interprétation des résultats. Les perspectives incluent le développement
d’essais cliniques plus inclusifs, la décentralisation des plateformes
de biologie moléculaire, la standardisation des seuils de détection
selon les profils génétiques, et l’intégration du ctDNA dans une vision
globale de médecine de précision équitable.
Source(s) :
Aronson, J., et al. (2025). Bridging the gap: ctDNA, genomics, and equity in breast cancer care. NPJ breast cancer, 11(1), 92 ;