05/11/2025
Les vitamines protègent-elles ou favorisent-elles le cancer de la prostate ? Une question de source et de dosage
Oncologie
Par Lila Rouland | Publié le 5 novembre 2025 | 3 min de lecture
Le cancer de la prostate (PCa) représente la cinquième cause de mortalité par cancer chez l’homme dans le monde. Si les facteurs de risque traditionnels (âge, origine ethnique, syndrome métabolique) sont bien établis, le rôle des vitamines dans la prévention du PCa reste controversé. Certaines études suggèrent un effet protecteur, d'autres indiquent un risque accru selon la forme et la quantité de l’apport.
Cette étude transversale, basée sur les données NHANES de 14 977 hommes américains de plus de 18 ans, évalue l'association entre la consommation de 10 vitamines (A, B1, B2, B6, B9, B12, C, D, E, K) par l’alimentation ou les compléments, et le risque de PCa.
L’analyse multivariée, ajustée sur plusieurs facteurs (âge, IMC, statut socio-éducatif, comorbidités), met en lumière des relations contrastées entre certaines vitamines et le risque de PCa, selon leur mode de consommation.
Un apport élevé en rétinol (vitamine A alimentaire) est significativement associé à une hausse du risque de PCa (OR = 1,76 ; p = 0,027). Les courbes de splines révèlent une relation non linéaire entre l’apport alimentaire de vitamines A, B6, B12, C et le risque de PCa, suggérant que les effets varient selon les doses.
À l’inverse, les vitamines du groupe B, en particulier les formes supplémentées, semblent exercer un effet protecteur :
Ces effets protecteurs pourraient s’expliquer par leur rôle dans la méthylation de l’ADN, la réparation cellulaire, et la modulation de la voie des androgènes. L’étude identifie également une interaction entre l’âge et les effets protecteurs de la vitamine B12, plus marqués chez les 18–59 ans.
En revanche, aucune association significative n’a été retrouvée entre le risque de PCa et les vitamines C, D, E ou K, que ce soit sous forme alimentaire ou supplémentée, malgré certaines données expérimentales suggérant un effet anticancéreux potentiel.
Cette étude révèle que l’excès de rétinol alimentaire pourrait accroître le risque de cancer de la prostate, tandis que la supplémentation en vitamines B1, B2, B9 et B12 pourrait jouer un rôle préventif. Ces résultats renforcent l’hypothèse selon laquelle la source et la forme d’administration des vitamines influencent leur effet biologique.
Cependant, les auteurs soulignent les limites méthodologiques : nature transversale de l’étude (pas de lien causal possible), risque de biais de mémorisation dans les rappels alimentaires, hétérogénéité des doses et durées d’exposition. De plus, les associations parfois non significatives après ajustement indiquent que des essais cliniques randomisés à grande échelle sont nécessaires pour valider ces observations.
Pour l’avenir, une approche intégrée combinant données nutritionnelles précises, analyses biologiques (dosages sériques) et suivi longitudinal permettra de mieux définir le rôle des vitamines dans la prévention du cancer de la prostate et de guider des recommandations nutritionnelles personnalisées, particulièrement chez les populations à risque.
À propos de l'auteure – Lila Rouland
Docteure en cancérologie, spécialisée en biotechnologies et marketing
Forte d’une double compétence scientifique et marketing, Lila met son expertise au service de l’innovation en santé. Après 5 années en recherche académique internationale, elle s’est tournée vers l’information médicale et scientifique en industrie pharmaceutique. Aujourd’hui rédactrice-conceptrice, elle s’attache à valoriser les savoirs scientifiques et à les transmettre avec clarté et pertinence aux professionnels de santé.
Le cancer de la prostate (PCa) représente la cinquième cause de mortalité par cancer chez l’homme dans le monde. Si les facteurs de risque traditionnels (âge, origine ethnique, syndrome métabolique) sont bien établis, le rôle des vitamines dans la prévention du PCa reste controversé. Certaines études suggèrent un effet protecteur, d'autres indiquent un risque accru selon la forme et la quantité de l’apport.
Cette étude transversale, basée sur les données NHANES de 14 977 hommes américains de plus de 18 ans, évalue l'association entre la consommation de 10 vitamines (A, B1, B2, B6, B9, B12, C, D, E, K) par l’alimentation ou les compléments, et le risque de PCa.
Un équilibre fragile : les vitamines ne se valent pas toutes face au cancer
L’analyse multivariée, ajustée sur plusieurs facteurs (âge, IMC, statut socio-éducatif, comorbidités), met en lumière des relations contrastées entre certaines vitamines et le risque de PCa, selon leur mode de consommation.
Un apport élevé en rétinol (vitamine A alimentaire) est significativement associé à une hausse du risque de PCa (OR = 1,76 ; p = 0,027). Les courbes de splines révèlent une relation non linéaire entre l’apport alimentaire de vitamines A, B6, B12, C et le risque de PCa, suggérant que les effets varient selon les doses.
À l’inverse, les vitamines du groupe B, en particulier les formes supplémentées, semblent exercer un effet protecteur :
- Vitamine B1 : supplémentation associée à une réduction de 62 % du risque (OR = 0,38 ; p = 0,036).
- Vitamine B2 : supplémentation associée à une réduction de 65 % du risque (OR = 0,35 ; p = 0,016).
- Vitamine B9 (acide folique) : supplémentation associée à une réduction de 35 % du risque (OR = 0,65 ; p = 0,049).
- Vitamine B12 : supplémentation (OR = 0,83 ; p = 0,030) et apport total (OR = 0,82 ; p = 0,037) réduisent significativement le risque.
Ces effets protecteurs pourraient s’expliquer par leur rôle dans la méthylation de l’ADN, la réparation cellulaire, et la modulation de la voie des androgènes. L’étude identifie également une interaction entre l’âge et les effets protecteurs de la vitamine B12, plus marqués chez les 18–59 ans.
En revanche, aucune association significative n’a été retrouvée entre le risque de PCa et les vitamines C, D, E ou K, que ce soit sous forme alimentaire ou supplémentée, malgré certaines données expérimentales suggérant un effet anticancéreux potentiel.
Stratégies nutritionnelles : cibler les bonnes vitamines pour réduire les risques
Cette étude révèle que l’excès de rétinol alimentaire pourrait accroître le risque de cancer de la prostate, tandis que la supplémentation en vitamines B1, B2, B9 et B12 pourrait jouer un rôle préventif. Ces résultats renforcent l’hypothèse selon laquelle la source et la forme d’administration des vitamines influencent leur effet biologique.
Cependant, les auteurs soulignent les limites méthodologiques : nature transversale de l’étude (pas de lien causal possible), risque de biais de mémorisation dans les rappels alimentaires, hétérogénéité des doses et durées d’exposition. De plus, les associations parfois non significatives après ajustement indiquent que des essais cliniques randomisés à grande échelle sont nécessaires pour valider ces observations.
Pour l’avenir, une approche intégrée combinant données nutritionnelles précises, analyses biologiques (dosages sériques) et suivi longitudinal permettra de mieux définir le rôle des vitamines dans la prévention du cancer de la prostate et de guider des recommandations nutritionnelles personnalisées, particulièrement chez les populations à risque.
À lire également : Alimentation végétale : un frein à la progression du cancer de la prostate ?
À propos de l'auteure – Lila Rouland
Docteure en cancérologie, spécialisée en biotechnologies et marketing

Dernières revues
Foie, sucre et pilules : qui mène le jeu ?

Par Ana Espino | Publié le 4 février 2026 | 3 min de lecture<br>
Endomètre : l’espoir renaît avec le PARP ?
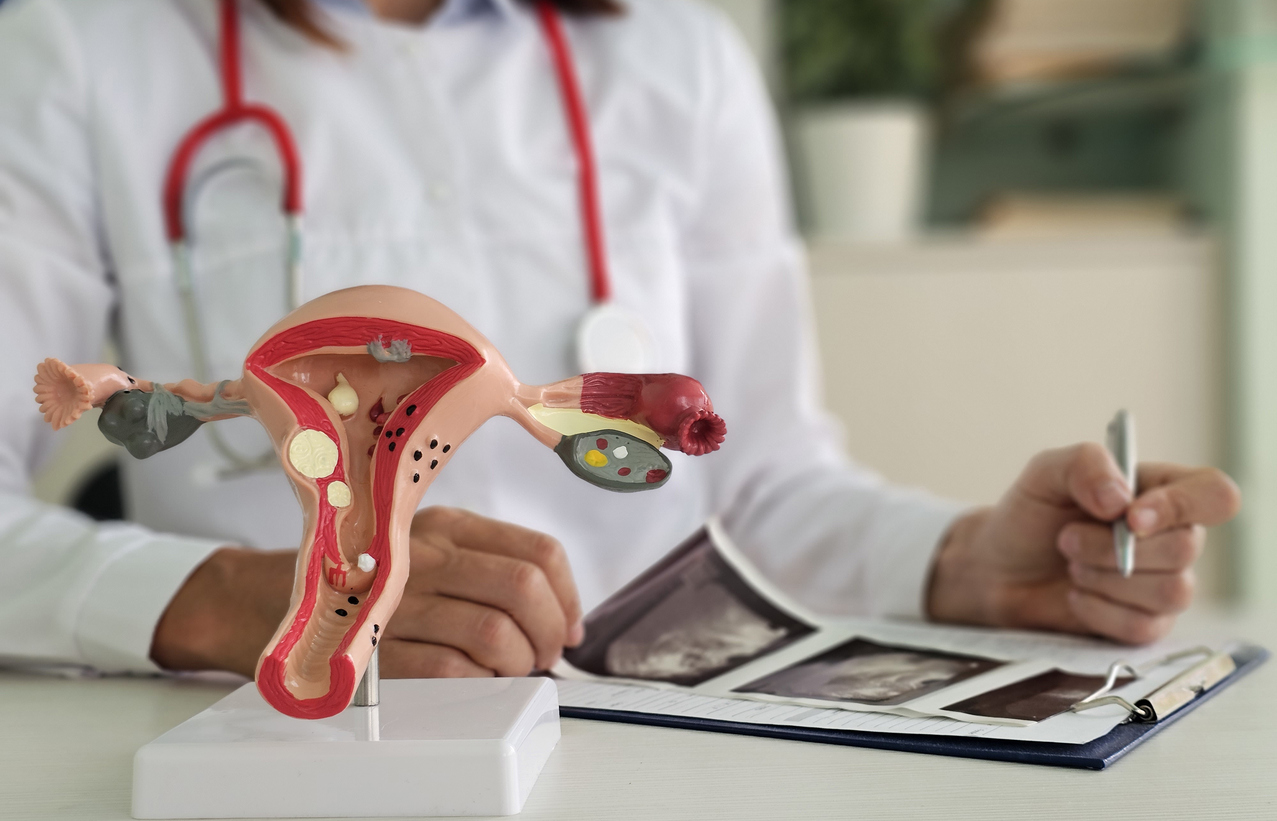
Par Ana Espino | Publié le 3 février 2026 | 3 min de lecture<br>
Des probiotiques pour des os en béton ?

Par Ana Espino | Publié le 2 février 2026 | 3 min de lecture