20/11/2025
Prostatectomie ou radiothérapie SBRT : quel traitement préservera mieux la qualité de vie ?
Urologie-néphrologie Oncologie
Par Lila Rouland | Publié le 20 novembre 2025 | 3 min de lecture
Chez les hommes atteints de cancer de la prostate localisé à risque faible ou intermédiaire, deux traitements curatifs sont aujourd’hui standards : la prostatectomie radicale et la radiothérapie stéréotaxique (SBRT). Tandis que la chirurgie est souvent perçue comme plus radicale, la radiothérapie est réputée moins invasive, mais ses effets secondaires, notamment intestinaux, soulèvent des interrogations.
L’étude PACE-A est le premier essai randomisé de phase 3 comparant directement la qualité de vie rapportée par les patients (PROs) après ces deux approches. Son objectif : évaluer, deux ans après traitement, les impacts spécifiques sur la continence urinaire, la fonction intestinale et la fonction sexuelle, afin d’éclairer les décisions thérapeutiques.
Résultats croisés : moins d’incontinence et de troubles sexuels après SBRT, au prix d’une gêne intestinale accrue
Entre 2012 et 2022, 123 hommes atteints de cancer localisé à bas ou moyen risque (94 % à risque intermédiaire selon NCCN) ont été randomisés (1:1) pour recevoir soit une prostatectomie radicale laparoscopique (n=60), soit une SBRT en 5 fractions (n=63). Aucun patient n’a reçu d’hormonothérapie. Les résultats à 24 mois s’appuient sur des questionnaires validés (EPIC-26, IIEF-5, IPSS, Vaizey), complétés par les patients à différents intervalles .
Deux ans après traitement, 50 % des patients opérés déclaraient utiliser au moins une protection urinaire par jour, contre seulement 6,5 % après SBRT (p < 0,001). L’écart estimé était de 43 points de pourcentage, en défaveur de la prostatectomie. Le score de continence (EPIC-26) reflétait cette tendance, avec une médiane de 77,3 après chirurgie contre 100 après SBRT (p = 0,003).
La gêne intestinale, mesurée par le domaine « bowel » de l’EPIC-26, était statistiquement plus marquée après SBRT (médiane : 87,5) qu’après chirurgie (médiane : 100) avec une différence moyenne de 8,9 points (p < 0,001). ès de 45Pr % des patients SBRT ont vu leur score chuter au-delà du seuil cliniquement significatif, contre seulement 14 % après chirurgie.
À deux ans, les scores sexuels (EPIC-26) étaient nettement inférieurs chez les patients opérés : médiane de 18 contre 62,5 après SBRT (p < 0,001). Les troubles érectiles étaient aussi plus fréquents et sévères : 63 % des patients opérés présentaient une dysfonction érectile de grade ≥2 contre 18 % après radiothérapie (p < 0,001).
Les toxicités génito-urinaires et gastro-intestinales de grade ≥2 étaient rares et comparables entre groupes, mais moins sensibles que les données rapportées par les patients. Ce décalage souligne l’importance d’inclure systématiquement les PROs dans l’évaluation des traitements. La qualité de vie au cœur du choix thérapeutique L’étude PACE-A fournit une preuve de niveau 1 en faveur d’une meilleure préservation de la continence et de la fonction sexuelle avec la SBRT, au prix d’une légère dégradation de la fonction intestinale. La chirurgie radicale, bien qu’efficace oncologiquement, entraîne plus souvent une incontinence urinaire persistante et une dysfonction érectile marquée.
Ces résultats doivent guider les cliniciens vers une approche plus individualisée, tenant compte des préférences du patient et de son profil de risque fonctionnel. La SBRT, bien tolérée et efficace, pourrait ainsi être privilégiée chez les hommes actifs ou préoccupés par la préservation de la qualité de vie sexuelle et urinaire. À l’inverse, les patients avec antécédents digestifs ou forte sensibilité intestinale pourraient bénéficier d’une approche chirurgicale.
Des études à plus long terme et avec un plus grand effectif permettront de confirmer ces tendances et de préciser les profils candidats idéaux pour chaque modalité.
À propos de l'auteure – Lila Rouland
Docteure en cancérologie, spécialisée en biotechnologies et marketing
Forte d’une double compétence scientifique et marketing, Lila met son expertise au service de l’innovation en santé. Après 5 années en recherche académique internationale, elle s’est tournée vers l’information médicale et scientifique en industrie pharmaceutique. Aujourd’hui rédactrice-conceptrice, elle s’attache à valoriser les savoirs scientifiques et à les transmettre avec clarté et pertinence aux professionnels de santé.
Chez les hommes atteints de cancer de la prostate localisé à risque faible ou intermédiaire, deux traitements curatifs sont aujourd’hui standards : la prostatectomie radicale et la radiothérapie stéréotaxique (SBRT). Tandis que la chirurgie est souvent perçue comme plus radicale, la radiothérapie est réputée moins invasive, mais ses effets secondaires, notamment intestinaux, soulèvent des interrogations.
L’étude PACE-A est le premier essai randomisé de phase 3 comparant directement la qualité de vie rapportée par les patients (PROs) après ces deux approches. Son objectif : évaluer, deux ans après traitement, les impacts spécifiques sur la continence urinaire, la fonction intestinale et la fonction sexuelle, afin d’éclairer les décisions thérapeutiques.
Résultats croisés : moins d’incontinence et de troubles sexuels après SBRT, au prix d’une gêne intestinale accrue
Méthodologie et profil des participants
Entre 2012 et 2022, 123 hommes atteints de cancer localisé à bas ou moyen risque (94 % à risque intermédiaire selon NCCN) ont été randomisés (1:1) pour recevoir soit une prostatectomie radicale laparoscopique (n=60), soit une SBRT en 5 fractions (n=63). Aucun patient n’a reçu d’hormonothérapie. Les résultats à 24 mois s’appuient sur des questionnaires validés (EPIC-26, IIEF-5, IPSS, Vaizey), complétés par les patients à différents intervalles .
Fonction urinaire : la radiothérapie protège mieux la continence
Deux ans après traitement, 50 % des patients opérés déclaraient utiliser au moins une protection urinaire par jour, contre seulement 6,5 % après SBRT (p < 0,001). L’écart estimé était de 43 points de pourcentage, en défaveur de la prostatectomie. Le score de continence (EPIC-26) reflétait cette tendance, avec une médiane de 77,3 après chirurgie contre 100 après SBRT (p = 0,003).
Fonction intestinale : un point faible de la SBRT
La gêne intestinale, mesurée par le domaine « bowel » de l’EPIC-26, était statistiquement plus marquée après SBRT (médiane : 87,5) qu’après chirurgie (médiane : 100) avec une différence moyenne de 8,9 points (p < 0,001). ès de 45Pr % des patients SBRT ont vu leur score chuter au-delà du seuil cliniquement significatif, contre seulement 14 % après chirurgie.
Fonction sexuelle : la chirurgie reste plus délétère
À deux ans, les scores sexuels (EPIC-26) étaient nettement inférieurs chez les patients opérés : médiane de 18 contre 62,5 après SBRT (p < 0,001). Les troubles érectiles étaient aussi plus fréquents et sévères : 63 % des patients opérés présentaient une dysfonction érectile de grade ≥2 contre 18 % après radiothérapie (p < 0,001).
Toxicités rapportées par les cliniciens : faibles dans les deux groupes
Les toxicités génito-urinaires et gastro-intestinales de grade ≥2 étaient rares et comparables entre groupes, mais moins sensibles que les données rapportées par les patients. Ce décalage souligne l’importance d’inclure systématiquement les PROs dans l’évaluation des traitements. La qualité de vie au cœur du choix thérapeutique L’étude PACE-A fournit une preuve de niveau 1 en faveur d’une meilleure préservation de la continence et de la fonction sexuelle avec la SBRT, au prix d’une légère dégradation de la fonction intestinale. La chirurgie radicale, bien qu’efficace oncologiquement, entraîne plus souvent une incontinence urinaire persistante et une dysfonction érectile marquée.
Ces résultats doivent guider les cliniciens vers une approche plus individualisée, tenant compte des préférences du patient et de son profil de risque fonctionnel. La SBRT, bien tolérée et efficace, pourrait ainsi être privilégiée chez les hommes actifs ou préoccupés par la préservation de la qualité de vie sexuelle et urinaire. À l’inverse, les patients avec antécédents digestifs ou forte sensibilité intestinale pourraient bénéficier d’une approche chirurgicale.
Des études à plus long terme et avec un plus grand effectif permettront de confirmer ces tendances et de préciser les profils candidats idéaux pour chaque modalité.
À lire également : Examen rectal digital dans le dépistage du cancer de la prostate : le moment est-il venu de repenser son rôle ?
À propos de l'auteure – Lila Rouland
Docteure en cancérologie, spécialisée en biotechnologies et marketing

Dernières revues
Foie, sucre et pilules : qui mène le jeu ?

Par Ana Espino | Publié le 4 février 2026 | 3 min de lecture<br>
Endomètre : l’espoir renaît avec le PARP ?
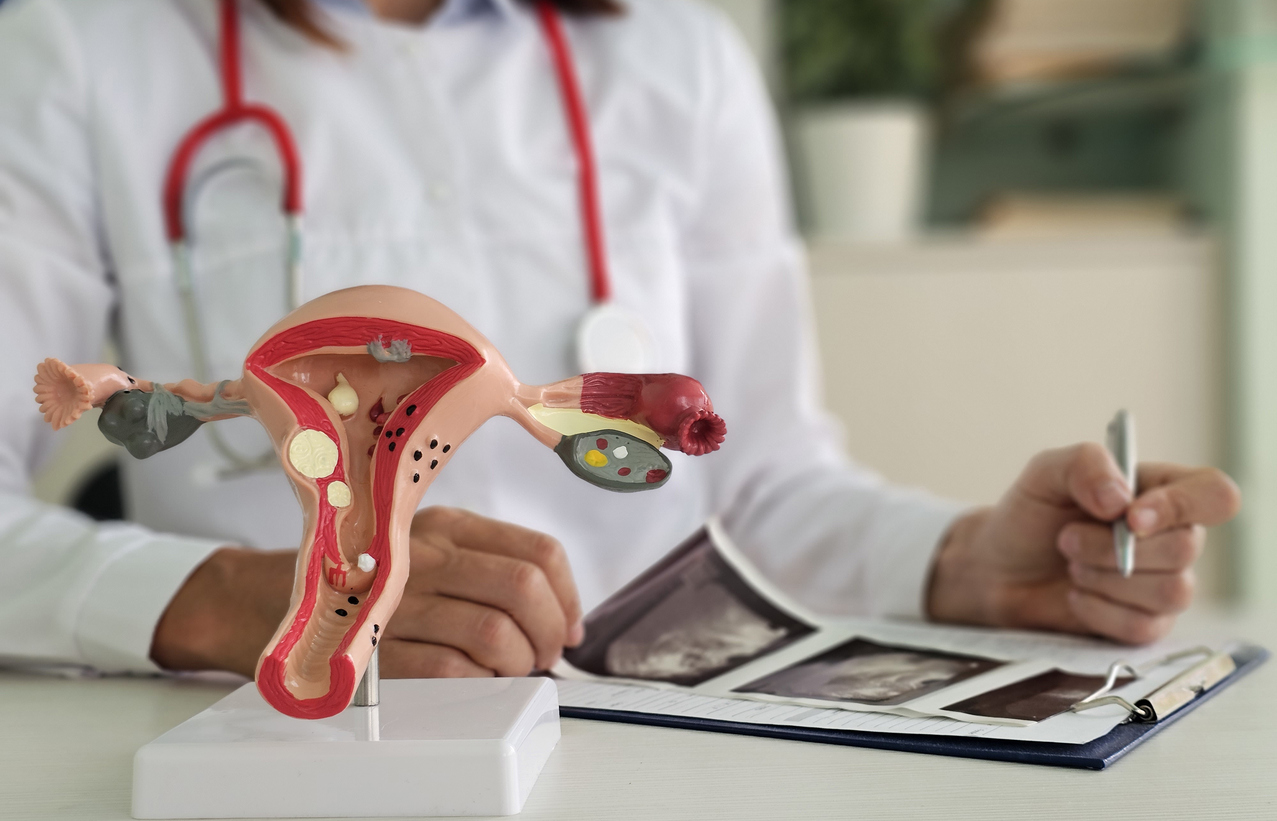
Par Ana Espino | Publié le 3 février 2026 | 3 min de lecture<br>
Des probiotiques pour des os en béton ?

Par Ana Espino | Publié le 2 février 2026 | 3 min de lecture