11/09/2025
Thérapies gonadotoxiques : l’utérus garde-t-il des séquelles durables ?
Endocrinologie et Métabolisme Gynécologie et Obstétrique
#Fertilité #Gynécologie #Chimiothérapie #Endocrinologie
Les traitements gonadotoxiques administrés durant l’enfance, l’adolescence ou le jeune âge adulte sont reconnus pour leur impact délétère sur la fonction ovarienne et la fertilité féminine. Si les atteintes ovariennes sont largement documentées, les effets sur l’utérus, et notamment sur son volume, restent moins étudiés, malgré leur rôle crucial dans la fécondité et les issues obstétricales. Cette zone d’ombre limite aujourd’hui la capacité à évaluer de manière complète le potentiel reproductif des femmes ayant survécu à un cancer pédiatrique ou jeune adulte.
Les données disponibles sur les conséquences utérines à long terme sont rares, hétérogènes et souvent limitées à de petites cohortes. En particulier, les effets spécifiques de la chimiothérapie seule, par opposition à ceux de la chimioradiothérapie, restent controversés. Cette absence de consensus freine la mise en place de stratégies de préservation de la fertilité adaptées, et complique le conseil reproductif individualisé.
Dans ce contexte, cette étude a été initiée afin d’évaluer l’impact des traitements gonadotoxiques sur le volume utérin.
Chimiothérapie seule : quel réel impact sur le volume utérin ?
Quatre études ont été sélectionnées et incluses dans l’analyse. Ces études totalisaient 225 femmes exposées à la chimiothérapie seule, 153 à une chimioradiothérapie, et 257 témoins sans antécédent de cancer. Le volume utérin a été évalué par échographie dans trois études et par IRM dans une. L’analyse a tenu compte de la parité, afin de limiter les biais liés à l’historique obstétrical. Les traitements ont ensuite été comparés et classés selon leur impact sur le volume utérin à l’aide de l’indice SUCRA.
Les résultats révèlent une réduction significative du volume utérin dans le groupe chimioradiothérapie, comparé à la fois aux témoins et au groupe ayant reçu uniquement une chimiothérapie. En revanche, aucune différence significative n’a été observée entre les femmes traitées par chimiothérapie seule et les témoins, suggérant une absence d’effet notable de cette modalité sur la taille utérine.
Ces tendances étaient plus marquées chez les nullipares, tandis que les données chez les femmes ayant déjà accouché étaient plus hétérogènes. L’analyse comparative par l’indice SUCRA (Surface Under the Cumulative Ranking Curve) a classé les groupes du plus au moins favorable en termes de volume utérin : témoins (0,91), chimiothérapie seule (0,57), et chimioradiothérapie (0,01).
Préserver la fertilité au-delà des ovaires ?
Les traitements gonadotoxiques administrés à un jeune âge peuvent compromettre la fertilité féminine, non seulement via l’atteinte ovarienne, mais aussi en altérant l’anatomie utérine. Pourtant, les effets sur le volume utérin restent peu explorés, en particulier chez les patientes exposées uniquement à une chimiothérapie. Ce manque de données fiables limite aujourd’hui l’évaluation globale du potentiel reproductif des survivantes de cancer et complique les stratégies de préservation de la fertilité.
Dans ce contexte, cette étude visait à comparer le volume utérin à l’âge adulte chez des femmes exposées à une chimiothérapie seule, à une chimioradiothérapie, ou non exposées. L’objectif était de déterminer si la chimiothérapie isolée induisait, à elle seule, une réduction significative du volume utérin. Les résultats montrent que la chimioradiothérapie est clairement associée à une réduction du volume utérin, tandis que la chimiothérapie seule ne semble pas avoir d’effet significatif par rapport aux témoins. Ces données suggèrent que les altérations utérines liées à la chimiothérapie sont probablement moindres, voire absentes, ce qui pourrait rassurer certaines patientes dans le cadre du conseil reproductif.
La mise en place de cohortes prospectives de plus grande envergure, intégrant des évaluations anatomiques, fonctionnelles et hormonales de la fonction utérine, avec un suivi à long terme, permettra de mieux caractériser les effets différenciés des traitements oncologiques. Une telle approche contribuerait à identifier les facteurs de risque spécifiques d’atteinte utérine et à affiner les stratégies de préservation de la fertilité, en élargissant le champ d’évaluation au-delà de la seule fonction ovarienne.
À lire également : Vacciner mieux, vacciner plus ?
À propos de l'auteure – Ana Espino
Docteure en immunologie, spécialisée en virologie
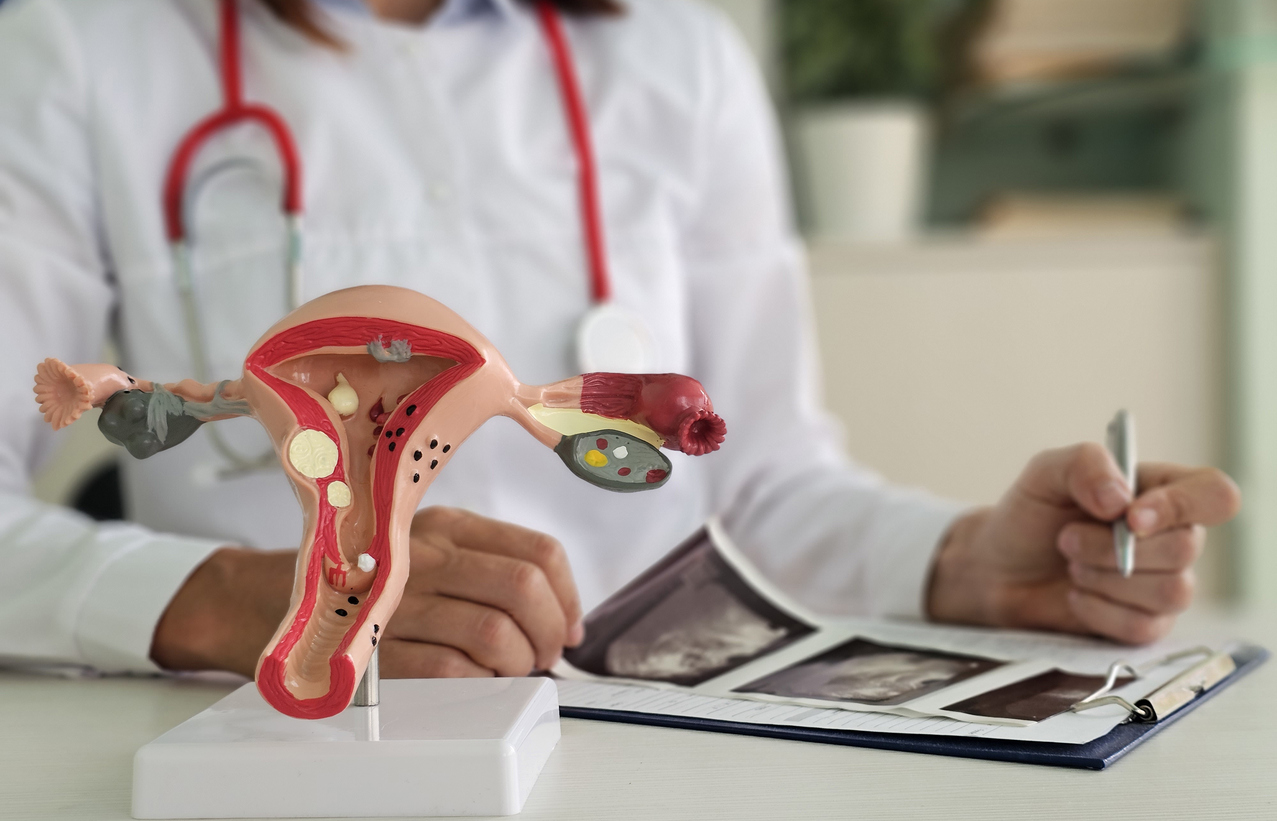
Dernières revues
Menace grippale émergente : l’essor rapide du sous-clade K de l’influenza A(H3N2) en Europe

Par Carolina Lima | Publié le 30 décembre 2025 | 3 min de lecture
L’exercice combiné, une stratégie gagnante pour la forme cardiorespiratoire post-cancer du sein

Par Lila Rouland | Publié le 29 décembre 2025 | 3 min de lecture<br>...
