19/05/2025
MICI : un fardeau double
Gastro-entérologie et Hépatologie
#SyndromeMétabolique
#MICI #MaladiedeCrohn #Corticothérapie #RectocoliteHémorragique
#InflammationChronique
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), telles que la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, sont reconnues pour leurs répercussions non seulement digestives mais également systémiques. Parmi ces complications, le syndrome métabolique (MetS) émerge comme un enjeu de plus en plus préoccupant. Les patients atteints de MICI présentent en effet un risque métabolique accru, lié à une interaction complexe entre inflammation chronique, dérèglements immunitaires et altérations métaboliques profondes.
L’inflammation de bas grade joue un rôle central dans la genèse du MetS, en favorisant la résistance à l’insuline, l’accumulation de tissu adipeux viscéral et la perturbation du métabolisme glucido-lipidique. La dysbiose intestinale persistante aggrave ce tableau, en perturbant la barrière épithéliale et en facilitant la translocation de molécules pro-inflammatoires vers la circulation systémique. En parallèle, les adipokines voient leurs niveaux déséquilibrés, renforçant le terrain métabolique inflammatoire. Enfin, l’usage prolongé de corticostéroïdes contribue directement à la prise de poids, à l’hyperglycémie et à la dyslipidémie. À ces mécanismes s’ajoutent des facteurs comportementaux non négligeables – sédentarité, régimes alimentaires restrictifs, etc. – qui participent à l’installation d’un profil cardiométabolique à risque.
Malgré cette convergence physiopathologique entre MICI et MetS, les données épidémiologiques disponibles restent fragmentées et hétérogènes, avec des résultats parfois contradictoires. Cette étude a donc été menée pour estimer avec précision la prévalence du syndrome métabolique chez les patients atteints de MICI. Elle visait également à comparer les taux entre la rectocolite hémorragique (RCH) et la maladie de Crohn (MC), et à identifier les facteurs cliniques associés tels que l’âge, le sexe et l’exposition aux traitements immunosuppresseurs.
12 études observationnelles – de cohorte et transversales – incluant plus de 1,1 million de patients atteints de MICI, issues de pays variés (États-Unis, Italie, Serbie, Corée du Sud, Japon, Turquie…) ont été sélectionnées. L’analyse statistique a été conduite selon les standards PRISMA avec le logiciel CMA v4.0, et une approche à effets aléatoires.
La prévalence globale du MetS chez les patients MICI a été estimé à 21,8%. Cette prévalence est significativement plus élevée chez les patients atteints de rectocolite hémorragique (32,7%) que chez ceux atteints de maladie de Crohn (14,1%). Par ailleurs, les patients MICI présentant un MetS sont en moyenne plus âgés que ceux sans syndrome, avec une différence d’âge moyenne estimée à 9,89 ans.
Bien que l’hétérogénéité inter-études soit importante, les analyses de sensibilité ont confirmé la robustesse de ces estimations, mettant en évidence une tendance claire. Le syndrome métabolique constitue une comorbidité fréquente et cliniquement significative chez les patients atteints de MICI, en particulier dans les formes coliques et chez les patients plus âgés.
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin sont des pathologies intestinales chroniques aux manifestations cliniques variées, principalement représentées par la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Longtemps abordées sous un angle exclusivement digestif, elles sont aujourd’hui reconnues pour leur impact systémique, notamment sur le métabolisme. Le principal défi est de mieux comprendre et anticiper les complications métaboliques associées aux MICI, en particulier dans un contexte de vieillissement des patients, d’inflammation persistante et d’exposition prolongée aux traitements immunosuppresseurs. Ces facteurs convergent pour aggraver le risque de syndrome métabolique, un état pathologique connu pour accroître la morbidité cardiovasculaire.
L’objectif de cette étude était de quantifier la prévalence du MetS chez les patients MICI, de comparer les données entre RCH et MC, et d’identifier les profils cliniques à risque. Les résultats montrent que près d’un quart des patients MICI présentent un MetS, avec une prédominance marquée chez les patients atteints de RCH et les individus plus âgés. Ces données confirment que le MetS constitue un enjeu croissant de santé publique dans cette population, avec un sur-risque cardiovasculaire documenté.
Des études longitudinales multicentriques sont désormais nécessaires pour établir des liens causaux robustes et évaluer plus finement l’impact des traitements (corticoïdes, anti-TNF, biothérapies) sur le risque métabolique. À terme, il paraît essentiel d’intégrer systématiquement le dépistage du MetS dans les parcours de soins des MICI, en lien avec une prise en charge nutritionnelle et endocrinologique personnalisée, pour limiter les complications à long terme.
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), telles que la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, sont reconnues pour leurs répercussions non seulement digestives mais également systémiques. Parmi ces complications, le syndrome métabolique (MetS) émerge comme un enjeu de plus en plus préoccupant. Les patients atteints de MICI présentent en effet un risque métabolique accru, lié à une interaction complexe entre inflammation chronique, dérèglements immunitaires et altérations métaboliques profondes.
L’inflammation de bas grade joue un rôle central dans la genèse du MetS, en favorisant la résistance à l’insuline, l’accumulation de tissu adipeux viscéral et la perturbation du métabolisme glucido-lipidique. La dysbiose intestinale persistante aggrave ce tableau, en perturbant la barrière épithéliale et en facilitant la translocation de molécules pro-inflammatoires vers la circulation systémique. En parallèle, les adipokines voient leurs niveaux déséquilibrés, renforçant le terrain métabolique inflammatoire. Enfin, l’usage prolongé de corticostéroïdes contribue directement à la prise de poids, à l’hyperglycémie et à la dyslipidémie. À ces mécanismes s’ajoutent des facteurs comportementaux non négligeables – sédentarité, régimes alimentaires restrictifs, etc. – qui participent à l’installation d’un profil cardiométabolique à risque.
Malgré cette convergence physiopathologique entre MICI et MetS, les données épidémiologiques disponibles restent fragmentées et hétérogènes, avec des résultats parfois contradictoires. Cette étude a donc été menée pour estimer avec précision la prévalence du syndrome métabolique chez les patients atteints de MICI. Elle visait également à comparer les taux entre la rectocolite hémorragique (RCH) et la maladie de Crohn (MC), et à identifier les facteurs cliniques associés tels que l’âge, le sexe et l’exposition aux traitements immunosuppresseurs.
MICI et métabolisme : un duo à surveiller ?
12 études observationnelles – de cohorte et transversales – incluant plus de 1,1 million de patients atteints de MICI, issues de pays variés (États-Unis, Italie, Serbie, Corée du Sud, Japon, Turquie…) ont été sélectionnées. L’analyse statistique a été conduite selon les standards PRISMA avec le logiciel CMA v4.0, et une approche à effets aléatoires.
La prévalence globale du MetS chez les patients MICI a été estimé à 21,8%. Cette prévalence est significativement plus élevée chez les patients atteints de rectocolite hémorragique (32,7%) que chez ceux atteints de maladie de Crohn (14,1%). Par ailleurs, les patients MICI présentant un MetS sont en moyenne plus âgés que ceux sans syndrome, avec une différence d’âge moyenne estimée à 9,89 ans.
Bien que l’hétérogénéité inter-études soit importante, les analyses de sensibilité ont confirmé la robustesse de ces estimations, mettant en évidence une tendance claire. Le syndrome métabolique constitue une comorbidité fréquente et cliniquement significative chez les patients atteints de MICI, en particulier dans les formes coliques et chez les patients plus âgés.
À lire également : Le sérum, une clé pour mieux traiter les MICI ?
Des MICI aux maladies métaboliques
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin sont des pathologies intestinales chroniques aux manifestations cliniques variées, principalement représentées par la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Longtemps abordées sous un angle exclusivement digestif, elles sont aujourd’hui reconnues pour leur impact systémique, notamment sur le métabolisme. Le principal défi est de mieux comprendre et anticiper les complications métaboliques associées aux MICI, en particulier dans un contexte de vieillissement des patients, d’inflammation persistante et d’exposition prolongée aux traitements immunosuppresseurs. Ces facteurs convergent pour aggraver le risque de syndrome métabolique, un état pathologique connu pour accroître la morbidité cardiovasculaire.
L’objectif de cette étude était de quantifier la prévalence du MetS chez les patients MICI, de comparer les données entre RCH et MC, et d’identifier les profils cliniques à risque. Les résultats montrent que près d’un quart des patients MICI présentent un MetS, avec une prédominance marquée chez les patients atteints de RCH et les individus plus âgés. Ces données confirment que le MetS constitue un enjeu croissant de santé publique dans cette population, avec un sur-risque cardiovasculaire documenté.
Des études longitudinales multicentriques sont désormais nécessaires pour établir des liens causaux robustes et évaluer plus finement l’impact des traitements (corticoïdes, anti-TNF, biothérapies) sur le risque métabolique. À terme, il paraît essentiel d’intégrer systématiquement le dépistage du MetS dans les parcours de soins des MICI, en lien avec une prise en charge nutritionnelle et endocrinologique personnalisée, pour limiter les complications à long terme.
À lire également : Faut-il voir plus large en chirurgie ?
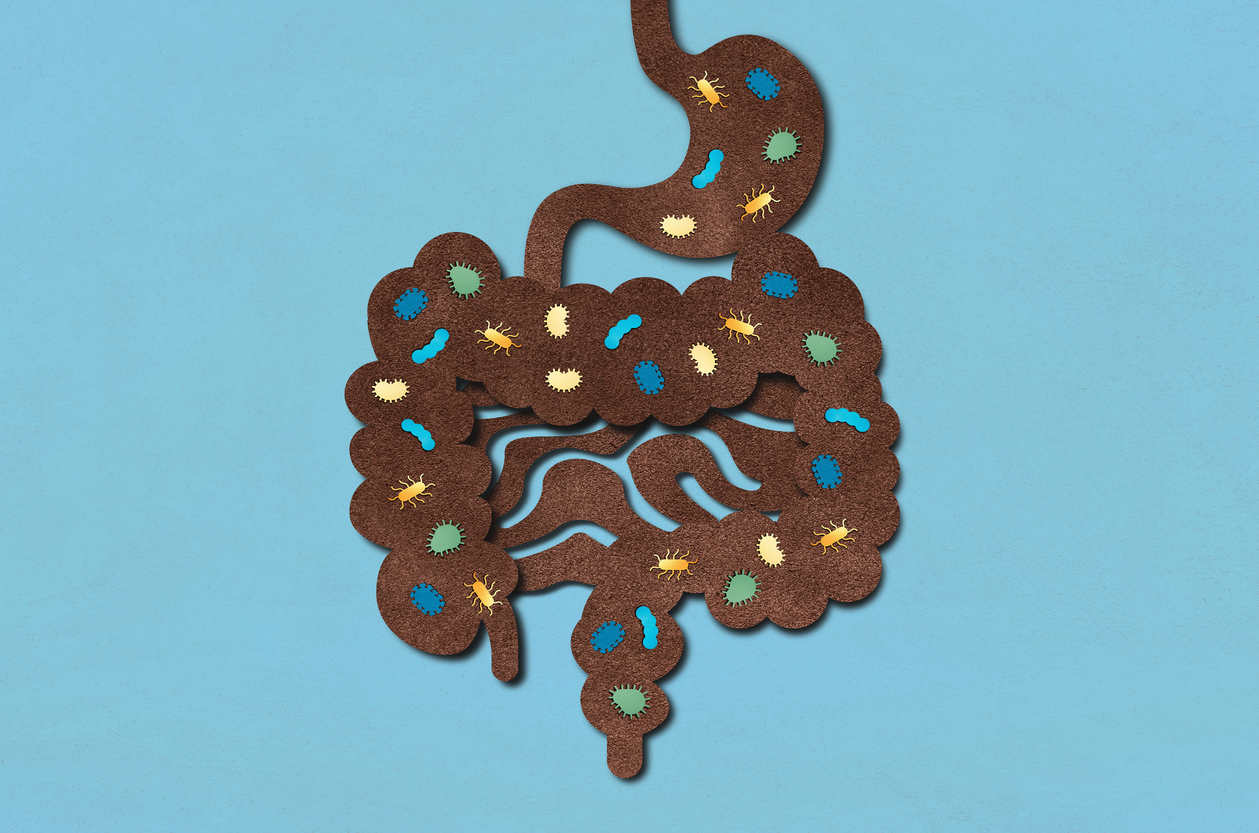
Dernières revues
Dépendances croisées : quand drogue et alcool se renforcent

Par Ana Espino | Publié le 8 janvier 2026 | 3 min de lecture...
Vaccins anticancer : une révolution en marche ?
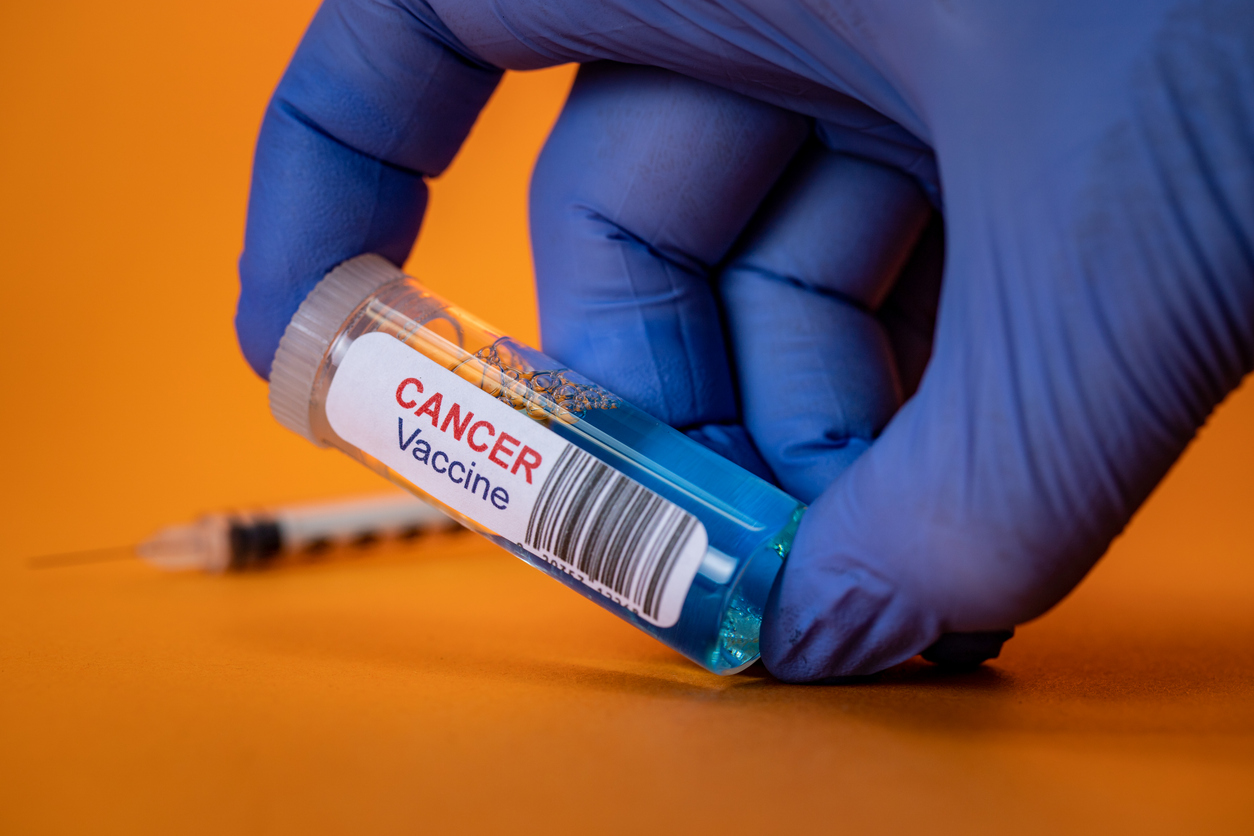
Par Ana Espino | Publié le 7 janvier 2026 | 3 min de lecture...
Saisonnalité et santé mentale : comment l’hiver et l’été façonnent notre esprit

Par Carolina Lima | Publié le 6 janvier 2026 | 3 min de lecture<br>