22/07/2025
Cancer du sein métastatique : que reste-t-il à (re)penser ?
Oncologie
Par Ana Espino | Publié le 22 juillet 2025| 3 min de lecture
#CancerduSein #mBC #Recommandations2025 #AGO
Le cancer du sein métastatique (mBC) demeure l’une des principales causes de mortalité liée au cancer chez les femmes. Malgré les avancées thérapeutiques majeures de ces deux dernières décennies, cette pathologie reste incurable, avec des récidives fréquentes et une réponse au traitement souvent limitée dans le temps. L’hétérogénéité moléculaire des tumeurs, la résistance secondaire aux traitements ciblés, la gestion des métastases complexes (osseuses, cérébrales, viscérales), et l’absence de lignes directrices unifiées pour certains profils moléculaires rares ou en progression post-CDK4/6 constituent des limites majeures dans la pratique clinique.
De plus, l’intégration de biomarqueurs comme le ctDNA dans les décisions thérapeutiques reste controversée, faute de validation définitive. Dans ce contexte, les professionnels de santé sont confrontés à des choix thérapeutiques complexes et évolutifs, nécessitant une mise à jour constante des pratiques fondées sur des données robustes. C’est dans cette perspective que le groupe AGO propose sa mise à jour 2025, avec des recommandations cliniques actualisées et hiérarchisées. Elles s’appuient sur les dernières preuves disponibles pour optimiser la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patientes atteintes de cancer du sein localement avancé ou métastatique.
Cette étude confirme la place centrale des biomarqueurs circulants dans le paysage diagnostique. Les cellules tumorales circulantes (CTCs) conservent une valeur pronostique élevée dans le mBC. Le ctDNA, bien que prometteur pour anticiper les rechutes et surveiller la réponse, n’est pas encore intégré dans les décisions thérapeutiques de routine, en raison de données encore insuffisantes. Sur le plan moléculaire, les mutations ESR1 et PIK3CA ouvrent la voie à des traitements ciblés personnalisés, notamment avec l’elacestrant ou l’alpelisib.
Chez les patientes porteuses de tumeurs HR+/HER2−, la combinaison d’un inhibiteur CDK4/6 avec une hormonothérapie reste la pierre angulaire de la prise en charge. Le ribociclib en association avec un inhibiteur de l’aromatase s’impose comme option prioritaire en première ligne, avec une recommandation AGO++. Lorsqu’une résistance endocrine apparaît, les alternatives comme l’elacestrant (SERD oral) ou le capivasertib (AKT inhibiteur) deviennent des stratégies pertinentes en seconde ligne.
Pour les formes HER2+, le trastuzumab deruxtecan (T-DXd) émerge comme traitement de référence en seconde ligne après échec initial, avec un net bénéfice démontré. Il peut être suivi, selon les profils, de la combinaison tucatinib, trastuzumab et capecitabine, notamment dans les formes avec atteinte cérébrale. Le diagramme décisionnel de la page 6 illustre clairement cette séquence thérapeutique.
Concernant les cancers triple-négatifs, les patientes PD-L1 positives bénéficient en première ligne d’une immunothérapie combinée, comme le pembrolizumab ou l’atezolizumab avec chimiothérapie. En cas d’échec ou progression, deux ADCs — sacituzumab govitecan et T-DXd — ont montré un gain de survie significatif, validant leur place dans les lignes ultérieures, comme détaillé page 5.
La gestion des métastases osseuses repose sur l’utilisation de zoledronate ou de denosumab, en association ou non avec des radiothérapies ciblées. Des protocoles prophylactiques sont également validés pour prévenir les événements squelettiques graves.
Enfin, dans le cas des métastases cérébrales, une approche localisée est recommandée en priorité pour les patientes présentant moins de quatre lésions, via chirurgie ou radiothérapie stéréotaxique (SRS). Dans les cas plus étendus, le T-DXd et le tucatinib ont démontré une efficacité intracrânienne et sont intégrés aux stratégies thérapeutiques systémiques, marquant une évolution notable dans la prise en charge des formes neurologiquement actives.
Le cancer du sein métastatique, bien qu’incurable, reste une pathologie où les progrès thérapeutiques permettent désormais une prise en charge plus ciblée et plus efficace. Face à la complexité croissante des profils tumoraux et à l’émergence constante de nouvelles approches, les professionnels de santé sont confrontés à des choix thérapeutiques de plus en plus nuancés. L’objectif de la mise à jour AGO 2025 est de fournir un cadre rigoureux, fondé sur les niveaux de preuve les plus récents, afin de guider les décisions cliniques dans un contexte en perpétuelle évolution.
Cette édition confirme l’intérêt des combinaisons ciblées, la pertinence des biomarqueurs dans l’approche personnalisée, et l’importance d’une stratégie intégrée incluant les soins de support et les métastases spécifiques. Toutefois, certaines recommandations restent conditionnées à des données encore incomplètes ou à des autorisations réglementaires non uniformes, limitant leur implémentation immédiate. Les perspectives à court terme résident dans l’intégration élargie de la biopsie liquide, l’évaluation continue des outils numériques et des PROs, et le développement d’approches plus individualisées fondées sur la biologie tumorale dynamique. Ainsi, l’AGO trace les contours d’une oncologie de précision, tournée vers une meilleure qualité de vie et une survie prolongée, même en contexte métastatique.
À propos de l'auteure – Ana Espino
Docteure en immunologie, spécialisée en virologie
Rédactrice scientifique, Ana est animée par la volonté de relier la recherche à l’impact concret. Spécialiste en immunologie, virologie, oncologie et études cliniques, elle s’attache à rendre la science complexe claire et accessible. Sa mission : accélérer le partage des savoirs et favoriser des décisions éclairées grâce à une communication percutante.
#CancerduSein #mBC #Recommandations2025 #AGO
Le cancer du sein métastatique (mBC) demeure l’une des principales causes de mortalité liée au cancer chez les femmes. Malgré les avancées thérapeutiques majeures de ces deux dernières décennies, cette pathologie reste incurable, avec des récidives fréquentes et une réponse au traitement souvent limitée dans le temps. L’hétérogénéité moléculaire des tumeurs, la résistance secondaire aux traitements ciblés, la gestion des métastases complexes (osseuses, cérébrales, viscérales), et l’absence de lignes directrices unifiées pour certains profils moléculaires rares ou en progression post-CDK4/6 constituent des limites majeures dans la pratique clinique.
De plus, l’intégration de biomarqueurs comme le ctDNA dans les décisions thérapeutiques reste controversée, faute de validation définitive. Dans ce contexte, les professionnels de santé sont confrontés à des choix thérapeutiques complexes et évolutifs, nécessitant une mise à jour constante des pratiques fondées sur des données robustes. C’est dans cette perspective que le groupe AGO propose sa mise à jour 2025, avec des recommandations cliniques actualisées et hiérarchisées. Elles s’appuient sur les dernières preuves disponibles pour optimiser la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patientes atteintes de cancer du sein localement avancé ou métastatique.
Quels traitements tiennent la promesse ?
Cette étude confirme la place centrale des biomarqueurs circulants dans le paysage diagnostique. Les cellules tumorales circulantes (CTCs) conservent une valeur pronostique élevée dans le mBC. Le ctDNA, bien que prometteur pour anticiper les rechutes et surveiller la réponse, n’est pas encore intégré dans les décisions thérapeutiques de routine, en raison de données encore insuffisantes. Sur le plan moléculaire, les mutations ESR1 et PIK3CA ouvrent la voie à des traitements ciblés personnalisés, notamment avec l’elacestrant ou l’alpelisib.
Chez les patientes porteuses de tumeurs HR+/HER2−, la combinaison d’un inhibiteur CDK4/6 avec une hormonothérapie reste la pierre angulaire de la prise en charge. Le ribociclib en association avec un inhibiteur de l’aromatase s’impose comme option prioritaire en première ligne, avec une recommandation AGO++. Lorsqu’une résistance endocrine apparaît, les alternatives comme l’elacestrant (SERD oral) ou le capivasertib (AKT inhibiteur) deviennent des stratégies pertinentes en seconde ligne.
Pour les formes HER2+, le trastuzumab deruxtecan (T-DXd) émerge comme traitement de référence en seconde ligne après échec initial, avec un net bénéfice démontré. Il peut être suivi, selon les profils, de la combinaison tucatinib, trastuzumab et capecitabine, notamment dans les formes avec atteinte cérébrale. Le diagramme décisionnel de la page 6 illustre clairement cette séquence thérapeutique.
Concernant les cancers triple-négatifs, les patientes PD-L1 positives bénéficient en première ligne d’une immunothérapie combinée, comme le pembrolizumab ou l’atezolizumab avec chimiothérapie. En cas d’échec ou progression, deux ADCs — sacituzumab govitecan et T-DXd — ont montré un gain de survie significatif, validant leur place dans les lignes ultérieures, comme détaillé page 5.
La gestion des métastases osseuses repose sur l’utilisation de zoledronate ou de denosumab, en association ou non avec des radiothérapies ciblées. Des protocoles prophylactiques sont également validés pour prévenir les événements squelettiques graves.
Enfin, dans le cas des métastases cérébrales, une approche localisée est recommandée en priorité pour les patientes présentant moins de quatre lésions, via chirurgie ou radiothérapie stéréotaxique (SRS). Dans les cas plus étendus, le T-DXd et le tucatinib ont démontré une efficacité intracrânienne et sont intégrés aux stratégies thérapeutiques systémiques, marquant une évolution notable dans la prise en charge des formes neurologiquement actives.
Une boussole pour l’incurable
Le cancer du sein métastatique, bien qu’incurable, reste une pathologie où les progrès thérapeutiques permettent désormais une prise en charge plus ciblée et plus efficace. Face à la complexité croissante des profils tumoraux et à l’émergence constante de nouvelles approches, les professionnels de santé sont confrontés à des choix thérapeutiques de plus en plus nuancés. L’objectif de la mise à jour AGO 2025 est de fournir un cadre rigoureux, fondé sur les niveaux de preuve les plus récents, afin de guider les décisions cliniques dans un contexte en perpétuelle évolution.
Cette édition confirme l’intérêt des combinaisons ciblées, la pertinence des biomarqueurs dans l’approche personnalisée, et l’importance d’une stratégie intégrée incluant les soins de support et les métastases spécifiques. Toutefois, certaines recommandations restent conditionnées à des données encore incomplètes ou à des autorisations réglementaires non uniformes, limitant leur implémentation immédiate. Les perspectives à court terme résident dans l’intégration élargie de la biopsie liquide, l’évaluation continue des outils numériques et des PROs, et le développement d’approches plus individualisées fondées sur la biologie tumorale dynamique. Ainsi, l’AGO trace les contours d’une oncologie de précision, tournée vers une meilleure qualité de vie et une survie prolongée, même en contexte métastatique.
À lire également : HER2, la clé pour révolutionner la lutte contre le cancer
À propos de l'auteure – Ana Espino
Docteure en immunologie, spécialisée en virologie
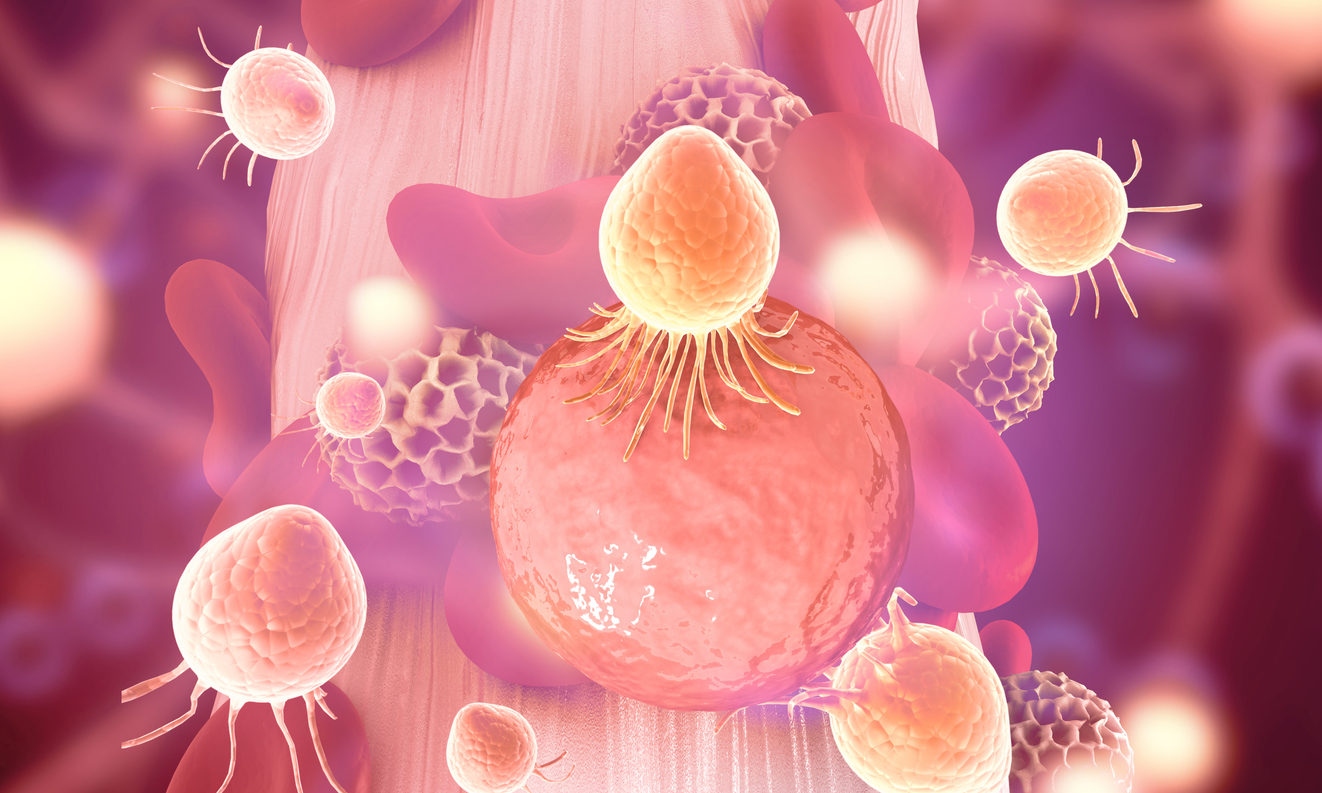
Dernières revues
La lèpre : une maladie encore hors de contrôle

Par Ana Espino | Publié le 22 janvier 2026 | 3 min de lecture
L’intoxication alcoolique parentale : un impact caché sur la santé mentale des enfants

Par Carolina Lima | Publié le 19 janvier 2026 | 3 min de lecture
Obésité : quand les reins saturent

Par Ana Espino | Publié le 20 janvier 2026 | 3 min de lecture