28/08/2025
L’IA peut-elle sauver des vies d’ados ?
Psychiatrie
Par Ana Espino | Publié le 28 août 2025| 3 min de lecture
#SuicidalitéAdolescente #IA #MachineLearning #Prévention
Le suicide se classe parmi les principales causes de mortalité chez les adolescents. De fait, il représente un enjeu de santé publique particulièrement préoccupant. Les méthodes classiques d’évaluation du risque reposent principalement sur des entretiens cliniques et des questionnaires standardisés. Elles présentent toutefois plusieurs limites majeures : sous-déclaration des symptômes, difficulté à détecter les signaux faibles et précoces, subjectivité dans l’interprétation des réponses, et pouvoir prédictif limité pour anticiper les comportements suicidaires.
Un défi majeur réside dans la mise au point d’outils capables de détecter de façon précoce, fiable et personnalisée les jeunes à risque, en intégrant une approche dynamique, sensible aux évolutions dans le temps, et adaptable à des contextes culturels variés. Dans cette perspective, l’essor de l’intelligence artificielle et des modèles d’apprentissage automatique ouvre de nouvelles possibilités pour analyser de larges volumes de données et identifier des schémas prédictifs complexes, invisibles aux approches traditionnelles.
C’est dans ce contexte que cette étude a été menée afin d’évaluer la capacité des modèles de machine learning à prédire le risque suicidaire chez les adolescents, de déterminer les facteurs prédictifs les plus pertinents et d’identifier les algorithmes les plus performants en vue d’améliorer la prévention et l’intervention ciblée.
24 études, publiées entre 2018 et 2024, portant sur plus de 14 000 participants adolescents ou jeunes adultes ont été sélectionnées.
Les données utilisées provenaient principalement de questionnaires psychométriques (PHQ-9, GAD-7), de dossiers médicaux électroniques et d’analyses de contenus issus des réseaux sociaux. Les modèles testés incluaient des algorithmes supervisés et non supervisés tels que Random Forest, Convolutional Neural Networks (CNN), Long Short-Term Memory (LSTM), ainsi que des approches plus classiques comme la régression logistique. Les facteurs prédictifs les plus puissants étaient la présence de dépression, d’anxiété, d’antécédents d’automutilation, l’isolement social et les conflits familiaux.
Les meilleurs résultats prédictifs ont été observés avec le Random Forest et les CNN, suivis de près par les LSTM. En comparaison, les modèles plus simples affichaient des performances nettement inférieures, confirmant l’intérêt des approches d’apprentissage avancées.
Par ailleurs, l’intégration de données multimodales – combinant simultanément des informations cliniques, comportementales et sociales – permettait d’améliorer sensiblement la précision prédictive, soulignant l’importance d’une vision globale et contextuelle pour anticiper le risque suicidaire.
Le suicide chez l’adolescent constitue un problème majeur de santé publique, nécessitant des outils de détection plus performants que les approches cliniques traditionnelles. Le défi est d’intégrer l’intelligence artificielle dans des stratégies de prévention précoces, fiables et personnalisées, capables d’identifier les signaux faibles avant que la crise ne survienne. Cette étude visait à déterminer si les modèles de machine learning pouvaient prédire efficacement le risque suicidaire à partir de données variées et à identifier les approches les plus prometteuses.
Les résultats confirment que certains algorithmes, notamment le Random Forest et les Convolutional Neural Networks, offrent une capacité prédictive élevée, en particulier lorsqu’ils s’appuient sur des données multimodales combinant informations cliniques, comportementales et sociales. Les prochaines étapes devraient inclure le développement de cohortes longitudinales à grande échelle, l’intégration de modèles interprétables pour une application clinique, et l’évaluation de leur efficacité au sein de programmes de prévention intégrés dans les établissements scolaires et les structures de santé, afin de renforcer la capacité d’action face à ce fléau.
À propos de l'auteure – Ana Espino
Docteure en immunologie, spécialisée en virologie
Rédactrice scientifique, Ana est animée par la volonté de relier la recherche à l’impact concret. Spécialiste en immunologie, virologie, oncologie et études cliniques, elle s’attache à rendre la science complexe claire et accessible. Sa mission : accélérer le partage des savoirs et favoriser des décisions éclairées grâce à une communication percutante.
#SuicidalitéAdolescente #IA #MachineLearning #Prévention
Le suicide se classe parmi les principales causes de mortalité chez les adolescents. De fait, il représente un enjeu de santé publique particulièrement préoccupant. Les méthodes classiques d’évaluation du risque reposent principalement sur des entretiens cliniques et des questionnaires standardisés. Elles présentent toutefois plusieurs limites majeures : sous-déclaration des symptômes, difficulté à détecter les signaux faibles et précoces, subjectivité dans l’interprétation des réponses, et pouvoir prédictif limité pour anticiper les comportements suicidaires.
Un défi majeur réside dans la mise au point d’outils capables de détecter de façon précoce, fiable et personnalisée les jeunes à risque, en intégrant une approche dynamique, sensible aux évolutions dans le temps, et adaptable à des contextes culturels variés. Dans cette perspective, l’essor de l’intelligence artificielle et des modèles d’apprentissage automatique ouvre de nouvelles possibilités pour analyser de larges volumes de données et identifier des schémas prédictifs complexes, invisibles aux approches traditionnelles.
C’est dans ce contexte que cette étude a été menée afin d’évaluer la capacité des modèles de machine learning à prédire le risque suicidaire chez les adolescents, de déterminer les facteurs prédictifs les plus pertinents et d’identifier les algorithmes les plus performants en vue d’améliorer la prévention et l’intervention ciblée.
Et si un algorithme voyait ce que l’on ne voit pas ?
24 études, publiées entre 2018 et 2024, portant sur plus de 14 000 participants adolescents ou jeunes adultes ont été sélectionnées.
Les données utilisées provenaient principalement de questionnaires psychométriques (PHQ-9, GAD-7), de dossiers médicaux électroniques et d’analyses de contenus issus des réseaux sociaux. Les modèles testés incluaient des algorithmes supervisés et non supervisés tels que Random Forest, Convolutional Neural Networks (CNN), Long Short-Term Memory (LSTM), ainsi que des approches plus classiques comme la régression logistique. Les facteurs prédictifs les plus puissants étaient la présence de dépression, d’anxiété, d’antécédents d’automutilation, l’isolement social et les conflits familiaux.
Les meilleurs résultats prédictifs ont été observés avec le Random Forest et les CNN, suivis de près par les LSTM. En comparaison, les modèles plus simples affichaient des performances nettement inférieures, confirmant l’intérêt des approches d’apprentissage avancées.
Par ailleurs, l’intégration de données multimodales – combinant simultanément des informations cliniques, comportementales et sociales – permettait d’améliorer sensiblement la précision prédictive, soulignant l’importance d’une vision globale et contextuelle pour anticiper le risque suicidaire.
Prédire pour prévenir : l’IA en première ligne
Le suicide chez l’adolescent constitue un problème majeur de santé publique, nécessitant des outils de détection plus performants que les approches cliniques traditionnelles. Le défi est d’intégrer l’intelligence artificielle dans des stratégies de prévention précoces, fiables et personnalisées, capables d’identifier les signaux faibles avant que la crise ne survienne. Cette étude visait à déterminer si les modèles de machine learning pouvaient prédire efficacement le risque suicidaire à partir de données variées et à identifier les approches les plus prometteuses.
Les résultats confirment que certains algorithmes, notamment le Random Forest et les Convolutional Neural Networks, offrent une capacité prédictive élevée, en particulier lorsqu’ils s’appuient sur des données multimodales combinant informations cliniques, comportementales et sociales. Les prochaines étapes devraient inclure le développement de cohortes longitudinales à grande échelle, l’intégration de modèles interprétables pour une application clinique, et l’évaluation de leur efficacité au sein de programmes de prévention intégrés dans les établissements scolaires et les structures de santé, afin de renforcer la capacité d’action face à ce fléau.
À propos de l'auteure – Ana Espino
Docteure en immunologie, spécialisée en virologie

Dernières revues
Pourquoi la thalidomide reste incontournable
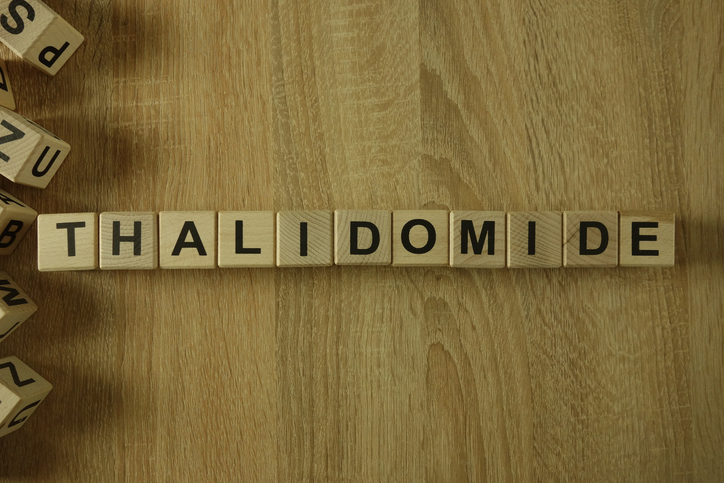
Par Ana Espino | Publié le 23 janvier 2026 | 3 min de lecture
La lèpre : une maladie encore hors de contrôle

Par Ana Espino | Publié le 22 janvier 2026 | 3 min de lecture
L’intoxication alcoolique parentale : un impact caché sur la santé mentale des enfants

Par Carolina Lima | Publié le 19 janvier 2026 | 3 min de lecture